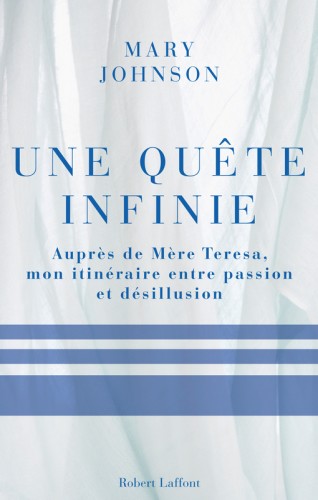
Robert Laffont, parution le 18 février 2013
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne Reiner.
480 pages, 22 €
Sous-titré « Auprès de Mère Teresa, mon itinéraire entre passion et désillusion », Une quête infinie est un captivant témoignage. Mary Johnson y raconte avec une impressionnante franchise, son parcours de nonne catholique. Cela commence un jour de 1975, où elle tombe sur une photo de Mère Teresa à la une du Time. Subjuguée par le personnage, elle prend alors, du haut de ses 17 ans, une importante décision vers laquelle convergeaient alors tout son être et ses plus profondes aspirations. Elle ne pouvait imaginer plus belle vie que celle qui se consacre entièrement à apporter soutien et compassion aux plus démunis de ce monde. Aucun membre de sa famille ne put la décourager d’arrêter ainsi ses études, pour se retrouver dix-huit mois plus tard dans un couvent du sud du Bronx, face à Mère Teresa, qui lui dit en accrochant un crucifix sur sa chemise « Reçois le symbole de ton époux crucifié. Porte sa lumière et son amour dans les demeures des pauvres partout où tu te rendras ». La voici donc novice chez les Missionnaires de la Charité. Mary Johnson y donnera vingt ans de sa vie. C’est donc un récit exceptionnel, vu de l’intérieur d’une de ces congrégations religieuses, qui souvent s’entourent d’ombre et de secrets pour mener à bien leur mission et accomplir leur vocation. Mary Johnson est alors une jeune fille un peu mal dans sa peau, qui n’intéressait pas les garçons, mais elle est intelligente, enthousiaste et dotée d’une foi qu’elle veut croire à toute épreuve. Mais la réalité est bien différente des rêves, et dès le premier jour nous pénétrons avec elle dans un monde clos, austère, difficile, exigeant et souvent injuste. Son enthousiasme et son idéal d’amour et de don total, se heurtent à des règles extrêmement rigides, paraissant parfois même moyenâgeuses, un monde où l’obéissance aveugle et sans condition est considérée comme la voie unique vers la sainteté. Mary Johnson dès le départ se retrouve confrontée au doute, à l’humiliation, à la remise en question de faits et gestes qui pourtant ne lui paraissent pas contradictoires avec la vie d’une Missionnaire de la Charité. Elle se sent pourtant prête à tous les sacrifices, elle veut travailler à devenir meilleure, pourvu qu’elle puisse se dévouer entièrement à sa mission, mais son esprit d’initiative, son intelligence et son sens de la justice, vont devenir alors ses pires ennemis. Ainsi devra t’elle, dès les premiers jours, accepter sans répliquer d’être traitée d’égoïste, de désobéissante, d’impudique, de paresseuse et de vaniteuse, tout cela pour avoir pris des douches et non utilisé un seau, alors qu’elle ne savait même pas qu’elle était censée le faire.
« Lorsqu’une sœur était corrigée, avait expliqué sœur Carmeline, même si l’accusation était injuste, elle devait demeurer silencieuse, comme Jésus devant Pilate. Je savais que ce n’était pas tout à fait exact – Jésus était resté silencieux devant Hérode mais pas devant Pilate. J’avais levé la main pour signaler cette erreur, mais je l’avais immédiatement abaissée : comme elle l’avait expliqué, mourir à soi-même et à la fierté était plus important que d’avoir raison, j’allais donc rester silencieuse, comme Jésus devant Pilate. »
Mary Johnson devient Sœur Donata, « celle qui se donne librement », car pour se donner à Jésus, il faut tout perdre, jusqu’à son propre nom. Et page après page, elle nous offre le récit de cette expérience unique, elle s’y livre intégralement, jusque dans les détails les plus intimes et les interdits qu’elle a enfreint, des amitiés particulières avec d’autres sœurs, allant jusqu’au plaisir charnel, et un amour profond et partagé avec un prêtre. Elle ne cache rien, non par goût de l’exhibition ou par provocation, mais dans un souci constant de vérité, de sincérité. Un besoin sans doute exacerbé par toutes ses années vécues dans un milieu où le secret et le silence étaient de mise, même quand il aurait été préférable de parler. On la suit ainsi de mission en mission, d’abord aux États-Unis, puis en Italie, à Rome. A sa plus grande déception, elle ne sera jamais envoyée plus loin, ses qualités et ses compétences, une fois de plus, se retournant contre elle, si bien qu’on lui confie toujours des taches qui ne lui permettent pas se consacrer véritablement à ce qui l’avait poussée, au départ, à rejoindre les Missionnaires de la Charité. On la voit se débattre avec des questionnements, des contradictions, des désirs, des obsessions et ce combat incessant entre ce qui lui semble naturel, voire même voulu par un Dieu d’amour, et le dogme, la honte, la culpabilité. Un combat qui durera vingt ans, avant que le besoin d’être soi, d’être dans l’amour véritable et non simplement dans une obéissance aveugle qui donne à la souffrance des odeurs de sainteté, ne devienne plus fort que tout. Cette obéissance aveugle à laquelle elle ne peut plus croire, ayant vu quel terreau elle était pour bon nombre d’injustices, en donnant raison aux plus intégristes, aux plus arrivistes, aux manigances de certain(e)s qui sous couvert de règles et d’intégrité théologiques se livrent aux plus viles manies humaines : manipulations, mensonges, cruauté, humiliations, pour assouvir leur soif de pouvoir, ce qui rappelle les plus sombres périodes inquisitrices. Un monde finalement bien éloigné de l’idéal Chrétien. C’est pourquoi Mary Johnson, au bout de vingt ans, prendra la courageuse et très difficile décision de quitter la congrégation pour ne plus jamais y retourner. Ce récit témoigne justement de comment une personne habitée d’une véritable vocation de don aux autres, d’un véritable esprit de compassion, un esprit christique dans le sens le plus profond, le plus libre du terme, se verra barrer la route dans ses aspiration les plus saines et les plus utiles et en arrivera au point d’y perdre toute joie et la santé.
Nous ne sommes là que pour aimer et être aimés répétait Mère Teresa et pourtant elle ne supportait pas d’être embrassée et si une sœur Missionnaire de la Charité ne pouvait prendre, ne serait-ce que la main d’une autre sœur dans la sienne, pour la réconforter sur un moment difficile, « Nous ne devions pas nous serrer la main, encore moins nous tapoter le bras ou nous toucher l’épaule et jamais, bien-sûr, nous étreindre », il leur était demandé par contre de pratiquer « la discipline » : « Mais tout en me fouettant les cuisses et en serrant les chaînes autour de mon bras et de ma taille, je découvris que je ne croyais plus que Dieu prenait du plaisir dans ma douleur. »
Sœur Donata se donnera à fond, elle fera taire ses réticences, fera tout son possible pour devenir une sœur accomplie telle que le conçoit Mère Teresa, qui voulait en faire de véritables saintes. Elle sera d’ailleurs appréciée de la plupart de ses compagnes, mais cela deviendra de plus en plus difficile, de plus en plus impossible d’aller à ce point contre elle-même d’une part, mais surtout contre ses convictions religieuses les plus profondes. « En attendant, je priais. Je savais à nouveau que Dieu résidait dans mon cœur, bien plus certainement qu’Il ne se trouvait dans les Règles. ». Elle en arrivera à maudire le jour où Dieu avait placé sous ses yeux, sur la couverture du magazine Time, le visage de cette femme ridée qui parlait de l’amour des pauvres.
« Et je ne me sentais plus à ma place. J’ai vu la Congrégation devenir de plus en plus étroite d’esprit. Ce n’était pas ce pour quoi je m’étais engagée. Je voulais apporter ma contribution, mais la congrégation ne semblait pas intéressée par ce que j’avais à offrir. »
Aussi, quand Sœur Donata prit la décision irrévocable de quitter la Congrégation, de redevenir Mary Johnson, et qu’elle se retrouva face à Mère Teresa, elle savait à quel point celle-ci ne pourrait pas comprendre.
« Savait-elle à quel point je détestais l’idée de la décevoir ?
« Ma Sœur, écoutez Mère Teresa. Parlez-lui. Pourquoi voulez-vous partir ? »
Tout me revient en mémoire. L’étouffement, les désillusions, la frustration, la soif de plus.
J’aurais voulu dire : Mère Teresa, mon Dieu n’est pas comme le vôtre. Votre Dieu vous demande de vous nier vous-même. Il compte chaque sacrifice et récompensera chaque acte de déni de soi. Votre Dieu est Jésus crucifié. Mon Dieu est celui de la résurrection – le Dieu qui dit : « Assez avec la souffrance. Guérissons le monde. »
Votre Dieu est un Dieu jaloux, qui dit : Tant que vous ne serez jamais trop proche d’un autre humain, je serai toujours proche de vous. » Mon Dieu dit : « Je vous offre des amis, je vous offre des amants. Je suis présent dans les gens que je vous donne. »
Ma Mère, j’aimerais que vous compreniez. Mais je ne peux pas prendre le risque que vous ne compreniez pas. Je ne veux plus de votre Dieu.
Sœur Donata quitta les Missionnaires de la Charité en 1997, trois mois avant le décès de Mère Teresa. Ce livre qui sort 10 ans après la béatification de celle qui reçut le prix Nobel de la Paix en 1979 et consacra sa vie aux plus pauvres d’entre les pauvres, apporte un autre éclairage sur le personnage de cette femme hors du commun. Un dévouement aussi total peut camoufler de grandes souffrances. Dans ce livre, Mary Johnson redonne à Mère Teresa sa dimension humaine, avec tout ce que cela implique d’imperfection.
« Mère Teresa en était ainsi arrivée à croire que ses sentiments de « torture et de douleur » faisaient plaisir à Dieu. Au cours des années, elle avait encouragée ses filles spirituelles à devenir des « victimes de l’amour divin ». Souvent elle disait aux malades : « la souffrance est le baiser de Jésus ».
Ses questions n’avaient finalement débouché que sur une détermination dogmatique à croire. Elle évitait les doutes en insistant, de manière intransigeante, sur les enseignements de l’Église, y compris ceux portant sur le contrôle des naissances, la place des femmes, sans tenir compte de la souffrance ou de l’injustice que ces enseignements perpétuaient.
Tant de choses dépendent des histoires que nous nous racontons et des questions que nous nous posons ou que nous ne voulons pas nous poser. »
Ce qui n’empêche que Mary Johnson éprouve un profond respect et un réel amour pour cette femme et à la fin de ce livre qu’elle dédie « à toutes ses sœurs où qu’elles soient », elle remercie les Missionnaires de la Charité « pour avoir enrichi et compliqué ma vie de manière inestimable et pour avoir été mes sœurs et mes frères ».
Nul besoin d’être catholique, ou justement de ne pas l’être, pour lire ce livre. Passionnant, il se lit comme un roman, et son plus grand mérite, est sans doute de montrer que la bonté et les aspirations spirituelles demeurent en chacune et chacun de nous, et que si la religion peut ou devrait être une des voies pour les réaliser, la primauté des règles sur l’intelligence du cœur, les raideurs et archaïsmes dogmatiques, l’aveuglement et les excès qu’ils entrainent, peuvent devenir au contraire, et ceci quelle que soit la religion, de graves entraves. Alors, s’en libérer, devient un véritable acte de foi, libre et responsable.
Cathy Garcia
 Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre, Une quête infinie, est traduit dans de nombreux pays.
Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre, Une quête infinie, est traduit dans de nombreux pays.


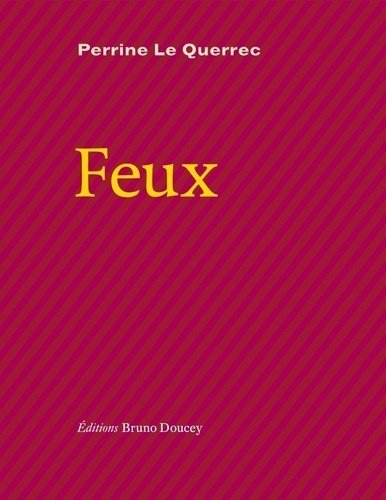
 Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle hante les bibliothèques et les archives pour assouvir son appétit de mots et révéler les secrets oubliés. De cette quête elle a fait son métier : recherchiste. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons.
Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle hante les bibliothèques et les archives pour assouvir son appétit de mots et révéler les secrets oubliés. De cette quête elle a fait son métier : recherchiste. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons.




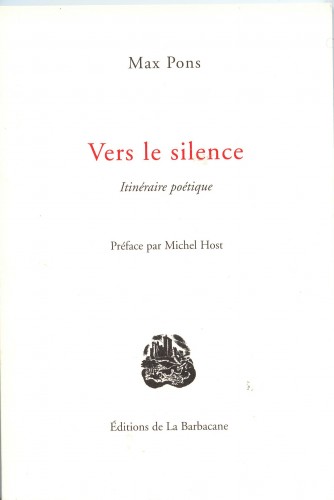
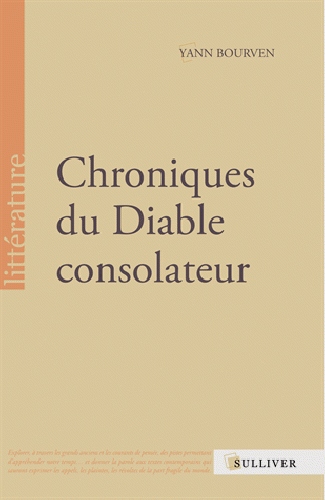

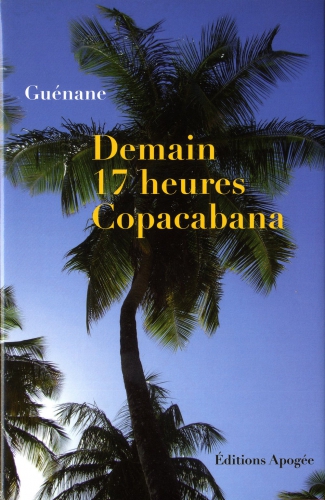
 La ville de Lorient ayant été anéantie par les bombes alliées, Guénane est née le 26 juillet 1946, "en exil" au cœur de la Bretagne. Elle a grandi dans la vallée du Blavet, fleuve canalisé par Napoléon, en un lieu où régnait une usine sidérurgique et où continue d'étouffer son enfance. Après des études de lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. Elle réside aujourd’hui en Bretagne Sud là où le Blavet se jette dans la mer.
La ville de Lorient ayant été anéantie par les bombes alliées, Guénane est née le 26 juillet 1946, "en exil" au cœur de la Bretagne. Elle a grandi dans la vallée du Blavet, fleuve canalisé par Napoléon, en un lieu où régnait une usine sidérurgique et où continue d'étouffer son enfance. Après des études de lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. Elle réside aujourd’hui en Bretagne Sud là où le Blavet se jette dans la mer.
 John Burnside a reçu le Forward Poetry Prize 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père. John Burnside est lauréat de The Petrarca Awards 2011, l'un des plus prestigieux prix littéraires en Allemagne.
John Burnside a reçu le Forward Poetry Prize 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père. John Burnside est lauréat de The Petrarca Awards 2011, l'un des plus prestigieux prix littéraires en Allemagne.









 La simplicité joyeuse et volontaire,
La simplicité joyeuse et volontaire, 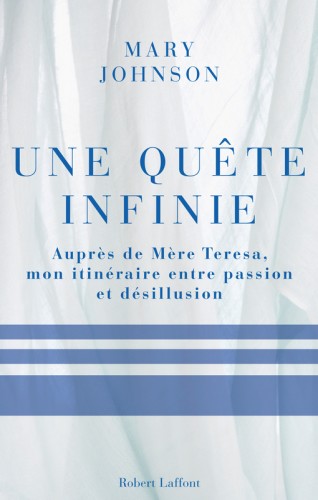
 Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre,
Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre,