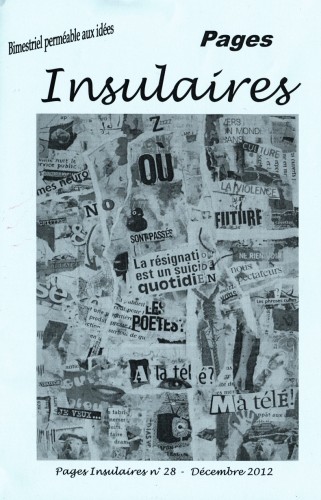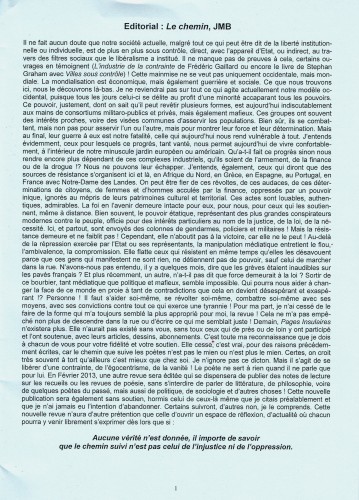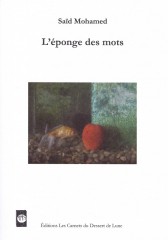
Les Carnets du Dessert de Lune – 2012. 128 pages, 12€.
L’éponge des mots est un livre sans commencement, ni fin, dans lequel on entre, puis on s’assoit et on écoute. On écoute un compagnon qui nous passerait la bouteille, on boirait à même le goulot, sans faire de manières, avant de la repasser à un autre, qui serait là aussi, quelque part au bord du monde, parce que toutes les routes ont déjà été arpentées, tout a été dit, et pourtant nul n’a encore trouvé le remède au mal de vivre.
L’éponge des mots éponge le trop plein.
Pas de gloire à se combler d’alcool
Pour s‘inventer des cataplasmes.
Boire encore et tordre le cou aux sortilèges.
Capitaine au long cours veillant sur l’histoire du hasard.
Taillader son chemin dans l’aventure des rues lisses.
Tel un Ulysse qui ne retrouvera jamais son port. Les mots eux-mêmes deviennent éponge pour absorber le trop plein d’amertume, de vanités, de désillusions, de chagrins rouillés. Un trop plein qui n’a d’équivalent que la béance du manque d’amour.
Revenir sur ton ventre noyer ma détresse à l’hôtel des carnages
en soudoyant le gardien de nuit
après une errance de bar en bar
pour resquiller la lumière
Lorsqu’on va chercher très loin ce que l’on ne trouvera jamais, le voyage devient errance, parce que depuis longtemps nous sommes perdus à nous-mêmes.
Dans cette nuit espagnole, tu pointes un doigt vers le ciel
et désignes l’aube avec sa rivière
roulant des perles noires.
(…)
Je jure de ne plus savoir retourner chez moi.
Car vivre c’est Être au monde avec ses pertes de lumière, des voiles trouées et ces haubans qui sifflent au moindre vent.
Dans L’éponge des mots, Saïd Mohamed nous livre son désenchantement, et à chaque page pourtant, on trébuche sur des pépites. Si les larmes sèchent vite aux vents des quatre coins du monde, les mots eux, n’ont pas fini de couler.
nous ne sommes pas devenus fou subitement,
cela a demandé du temps.
D’abord, on a vu l’étrange plaie
qu’est la joie dans les yeux des autres.
(…)
Pris dans la tourmente des loups dépouillés
qui guettent l’étrange et le dérisoire.
Partout avec ces mots de pauvre, aller
dans la perception des miroirs
en traversant sur les passages cloutés.
Les mots vomissent leur impuissance à changer le monde.
Il n’est de sommeil plus puissant
Que notre intelligence à ne pas vivre
(…)
L’idiot va à ses ratages comme à une science exacte,
Seule raison valable pour achever cette bouteille.
Quelle autre sagesse peut évoquer un tel carnage ?
Le voyageur va chercher ailleurs quelque chose qui lui ferait croire qu’il vit plus intensément.
La dentelle des jours nous pousse à faire escale
dans les ports aux romances inachevées,
à chercher dans la multitude des petits riens
ces choses de peu qui manquent le plus.
Plus c’est loin et plus on espère trouver cet autre chose qui nous ferait nous-mêmes autre.
J’ai connu les ventres outragés et le rire des singes,
L’ombre du feu avec dans la bouche
Les cendres des morts comme seule preuve de vie
Et combien de corbeaux, de singes, de najas,
D’étranges banyans et d’immenses
Oiseaux de nuit.
Mais il y a quelque chose de définitivement voué à l’échec dans cette quête, des courants contraires aux chercheurs d’intensité, des trésors éphémères qui fondent comme goutte d’eau au soleil.
Des éclats de possibles,
des bribes de rien dans le silence résorbé des villes
et des hommes de papier mâché
au bar des illusionnistes.
(…)
Partout être à contretemps,
à contre-emploi, à contresens du flux
dans le décalage permanent,
fuir quand tout converge.
Grande est la désillusion, quand on découvre les coulisses de ce qui n’apparait au final, comme rien d‘autre qu’un grand cirque pathétique.
Qu’auront nous dit vraiment ?
Le silence est préférable à ces babils,
ces faux-savoirs,
ces mensonges appris comme une leçon.
Ces bribes de rien, de tout, d’abject aussi, récitées par cœur
quand le plus grand dénominateur commun ouvre sa gueule
dans l’immonde barnum du tube cathodique,
ce rectum de la pensée qui souille
tout ce qu’il touche.
Saïd Mohamed sait ce qui pousse à Parcourir le monde comme le sang bat les veines à la recherche de l’instant qui rend caduc tous les autres. (…) et la promesse toujours la promesse d’autres choses encore.
Le voyage, la fuite, la solitude et l’oubli impossible.
Accolé aux murs des villes, ton visage, ton sourire obsédant, ton ventre au mien accroché, où dedans le vent s’engouffre, dans le salpêtre, la crasse, l’odeur des poubelles, je t’ai cherchée.
Dans le repli de l’indifférence j’ai appris à regarder avec cette habitude à qui rien n’échappe, en tous lieux j’erre seul, heurté à la raison qui maintient les êtres dans leur camisole. Partout où tu as posé les pieds, je retourne la terre. J’hésite à te nommer, pour laisser en friches ces souvenirs qui me reviennent, m’accablent et me jettent dans les bras d’hier.
Saïd Mohamed sait qu’il est difficile de vivre en ignorant son ombre, elle se tord et crie si on marche dessus.
Tout au long de son livre on sent peser cette ombre qu’aucune destination, si lointaine fut-elle, aucun alcool, ne sauraient dissiper.
Tous ces arbres morts qui s’évertuent à lancer au ciel des branches pour s’y pendre…
Et pourtant, nous confie t-il, ma raison demeure dans l’agitation du monde, de ces villes juchées les unes sur les autres, où dans l’ennui les hommes se laminent, se chevauchent.
Dans la troisième partie du livre, il nous ramène à un « Ici et maintenant ». Une sagesse que connaissent tous ceux qui savent qu’il est vain de tenter d’être ailleurs, que dans ce laps de temps présent. Et si les souvenirs sont toujours là, en filigrane, il est temps de tirer un trait et Saïd Mohamed est sans doute un de ces êtres brûlés au feu de la passion comme de la lucidité, cette lucidité féroce qui pousse à n’importe quel extrême pour lui échapper, en vain.
Nous n’avons pas grandi malgré le poids sur nos épaules.
Prisonnier de l’enfance, on croit être devenu un autre
en refusant l’idée que seul le corps change.
L’éponge des mots est comme un fleuve qui s’écoule, qui déborde parfois, puis se calme à nouveau, qui remonte le temps aussi bien qu’il file vers une hypothétique embouchure.
On relit ce qu’on a écrit sans le reconnaître.
Ivresse de la prière païenne qui se nourrit d’elle-même
À laquelle aucun parler n’est comparable.
Ce mystère ne nous appartient pas.
En bouche vient le fleuve,
Message jamais interrompu ni commencé.
Il y a l’ombre, mais aussi un flot de lumière, au sein même de ce qui peut sembler comme un constat désespéré.
Dire l’instant émerveillé devient insolence
Aux hommes obscurcis par trop de misère.
L’auteur sait qu’avec les mots on peut tout inventer et il a gardé Des affamés (…) les vertus de l’illumination, les tenailles du silence et la tyrannie de l’aube.
En d’autres termes, le chant et la soif du poète, mais il s’interroge sans cesse, il nous interroge.
Comment apprécier l’insolence des moineaux et convaincre l’ombre du bien-fondé de la lumière
Survivre aux ratages de l’existence et à cette nostalgie qui éreinte.
Il faut avoir touché le fond pour en connaître la texture réelle et savoir si bien en rendre compte.
Le mal de vivre n’a pas de nom, inquiétude rebelle, cœur sans raison.
Le voyageur a vu la face périmée du rêve et le poète l’a bue jusqu’à la lie.
L‘insulte nous a cueillis au cœur de la joie. Déplumé l’oiseau aux sept couleurs. Sidaïque l’oncle Jo des Amériques. La petite Jeanne s’injecte de l’héroïne.
Comme des orphelins, efflanqués nous ne croyons plus en rien. Nous avons vu tant de désastres, de boue ruisseler des montagnes, de louves pleines les flancs ronds, de vagabonds pointer sur la carte du ciel une étoile rouge.
Et comme ces marins condamnés à errer d’île en île, lui comme nous sommes étrangement ballotés entre l’histoire d’un monde aux urgences de grisaille et l’impatience de vivre.
Saïd Mohamed n’a certainement pas fini d’essorer, encore et encore, L’éponge des mots, et c’est tant mieux !
Cathy Garcia
 ©photo de Bénédicte Mercier
©photo de Bénédicte Mercier
Saïd Mohamed, né en 1957, en Basse-Normandie, d’un père berbère, terrassier et alcoolique et d’une mère tourangelle lavandière et asociale, il a passé son enfance et son adolescence à la DASS. Nomade dans l’âme, il a été tour à tour, ouvrier imprimeur, voyageur, éditeur, chômeur, enseignant. Chef de fabrication dans le secteur éditorial, il a enseigné au BTS édition à Toulouse et poursuit désormais son enseignement à Paris, dans le cadre de la prestigieuse École Estienne.
Romans
Un enfant de cœur, Éditions EDDIF, Casablanca, 1997.
La Honte sur nous, Éditions Paris Méditerranée, 2000. Éditions EDDIF, Casablanca, 2000 (réédition 2011, Ed. Non–lieu).
Le Soleil des fous, Éditions Paris Méditerranée, 2001.
Putain d’étoile, Éditions Paris Méditerranée, 2003.
Poésie
Terre d’Afrique, S’éditions, 1986.
Mots d’absence, Le Dé Bleu, 1987.
Délits de faciès, Le Dé Bleu, 1989.
Femme d’eau, Polder, 1990.
Le Vin des crapauds, Polder, 1995.
Jours de pluie à New York, de cendres à Paris et de neige à Istanbul, Encres Vives, 1995. Réédition 2001.
Lettres mortes, Poésimage, 1995.
Chaos, Éditions Ecbolade, 1997.
Point de fuite, Propos de Campagne, 1998.
Instants fragiles, Le Maghreb Littéraire, Toronto, 1999.
Liesse à Marrakech, Encres vivres, 2001.
 Le 75e numéro du Microbe est prêt !
Le 75e numéro du Microbe est prêt !
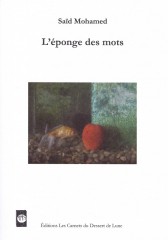
 ©photo de Bénédicte Mercier
©photo de Bénédicte Mercier