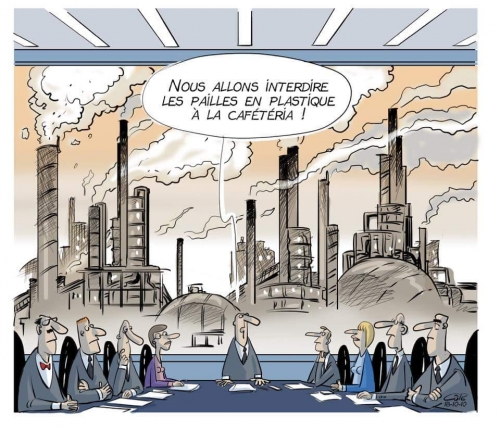Erri de Luca
On se trouve aussi dans une guerre par honte de rester à l’écart.
Et puis un deuil te saisit et t’y maintient pour être soldat de rage.
in Trois chevaux
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
On se trouve aussi dans une guerre par honte de rester à l’écart.
Et puis un deuil te saisit et t’y maintient pour être soldat de rage.
in Trois chevaux




La vertu, l’éthique ne consistent pas dans la répétition du bien.
Toute vertu cesse d’en être une dès qu’elle devient mécanique.

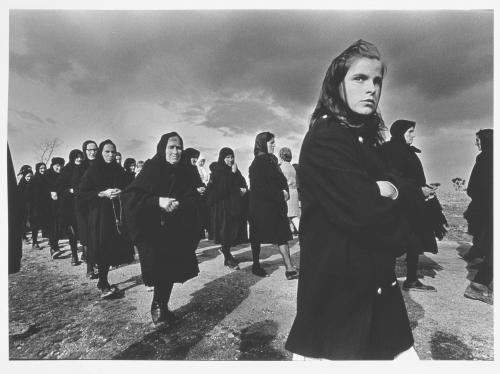







« Si gît un malheureux sergent
qui fut pendeu le vit bandent
contre lordre de la nature
un moine passant par le port
le voyant en ceste posture
crut quil vouloit foutre la mort ».