Petite Poissonne

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.



Voici trois textes produits lors de l'atelier "Immersion dans le réel", animé par moi-même dans le cadre du collectif Fourmillard, sur Cahors, le 5 septembre dernier. Pour le plaisir du partage de cette expérience qui fut des plus intéressantes et qui sera très certainement renouvelée.

(photo : patoufette)
Déambulations
Petit square, végétalisé par la main de l'homme. Assise sur un banc métallique, je vois, j'entends, je respire. Je goûte seulement à la tranquillité des lieux ; enfin, pas tout à fait ! Non loin d'ici me parviennent les bruits de la ville, et surtout le vrombissement des moteurs automobiles. Deux éléments m'interrogent et appellent mon regard : le gigantisme d'une statue de pierre, un centaure tout droit venu de la mythologie grecque, figé, érigé, scellé depuis et pour des siècles. Et ces escaliers agrémentés d'une voute végétale : où peuvent bien conduire ces larges marches descendantes, dont je ne distingue d'ici que la pénombre, un début d'obscurité...
Dans le vent bruissant et frissonnant, passants anonymes et pigeons s'animent au cœur du petit square. Mais toi, mon amie perdue, inanimée, évanouie, volatilisée pour toujours dans une nuée de cendre, qu'il m'eut plu de te retrouver ici, de manière impromptue. De t'apercevoir, d'entendre ton rire si familier, si distinctif et qui claironne encore à mes oreilles. Oh oui, t'apercevoir seulement, seulement pour infirmer, pour démentir cette absence de l'amie, à la vie à la mort. Me suffit-il de penser : jusqu'à la mienne tu continueras de vibrer, d'exister pour moi. Alors, peu importe si ton rire n'a pas résonné au cours de cette visite au cœur de Cahors.
Cathédrale Saint Étienne : neuf-cent ans d'histoire chrétienne. Pause en son cloître. Que de formes, que de matériaux employés pour une esthétique parfois disharmonieuse ; au sommet de ses colonnes sculptées : gargouilles, parfois méconnaissables tant l'usure des siècles a fait son œuvre. Édifice en pavés du Quercy - blanc, beige, gris - parfois noircis par le Temps et les frottements. Mon regard vers le ciel, cette envie irrépressible d'échapper à ces lieux dits sacrés ; mais celle, irrésistible, d'aller à la rencontre du souvenir de Vous. Vous mes si chers cousins, catholiques de confession et qui ont si chaleureusement, si joyeusement agrémenté ma vie des décennies durant. Tous "partis". Toute orpheline je reste. Dans ce cloître cadurcien, il m'importait de me relier à vous par le cœur et en pensée. Que vous m'entendiez, j'en doute un peu, et même beaucoup ! Mais que je vous l'dise quand même : votre "Absence" de ma vie me laisse un goût de profonde mélancolie. La vie donnée. La vie reprise, comme le souffle du vent, que la nature engendre et livre à son destin. A quoi bon prier ?... Mon athéisme n'entend rien à cela. Hermétique, mais par tant de sensations humaines habitée, alertée, démultipliée. Vivante.
Vivante, vibrante cette placette moderne au sol pavé. Toute encadrée de hautes façades érigées et de divers petits commerces au niveau inférieur. Cernée encore de mille et hautes fenêtres, d'où une légère sensation d'enfermement. Un lieu urbain donc et aménagé pour les besoins des citadins ; y trône aussi quelques spécimens végétaux majestueux aux nombreuses ramifications conduisant au feuillage. Lui-même enguirlandés comme il l'est au cœur de l'été, doivent s'y donner quelques réjouissances nocturnes pour le plaisir des Cadurciens ou estivants de passages.
Sous ce carré bleu du ciel, nous quatre, assis en terrasse pour y prendre une collation, achevant ainsi notre déambulation dans ce cœur de ville. Réflexifs encore puisque dernière étape de cet atelier d'écriture quelque peu improvisé. Les bruits divers mais continus, le souffle de l'air qui circule de part en part, vient ventiler nos poumons et vivifier notre esprit. Nous seulement faisons silence, car la circulation automobile, incessante, l'écho des voix humaines et même animales tout autour de cette brasserie Velvet emplissent nos oreilles sans discontinuer.
Tous les sens en éveil. Toute liberté de penser, de ressentir, de voir, de toucher, d'entendre, de goûter, mais... une liberté assiégée, conditionnée par le contexte, les circonstances du lieu, du vacarme ambiant, de sa population, de cette agitation propre à la vie citadine : peu appropriée à l'activité intellectuelle en général.
Retour à la boutique d'Artisanat local où nous ferons lecture des annotations sensitives de chacun. Moments de partage aussi utiles qu'inspirants ; que tout pratiquant peut non seulement comprendre mais apprécier. L'écriture ne se nourrit-elle pas d'échanges, de voyages au sens large, d'émotions, de sentiments, d'expériences, de sensations en tous genres... Oui ! les Passionnés, les "Mordus" de la plume savent bien tout ça !
M-A

(auteur inconnu)
Entre les murs
La ville petite s’est rétrécie : un jardin public, un cloître, un café sur une place. Partout des murs. Pour protéger les pigeons à mes pieds ou pour enfermer le bruit du vent.
Dans le jardin petit, une rose toute seule, bouge, dodeline sur sa tige érigée vers le ciel. Têtue, elle dit oui, oui, oui au vert, au pourpre, à l’odeur d’épice, tenace. Dans le jardin carré, un centaure dans un carré de terre s’enracine, sans racines. Autour, d’autres carrés de terre imitent un jardin. Le centaure au corps couleur platane ne bouge pas. Il écoute le silence, entre deux voitures, pas souvent. Au dessus du jardin petit, les briques des maisons sont bien rangées. Elles sont réfractaires au bruit des voix dans la rue et aux bourrasques de vent qui s’agitent dans les feuilles. Une porte en bois s’ouvre toute seule. Les nuages passent très vite, le soleil aussi. Un homme âgé avance avec prudence, il a l’expérience. Son caniche est gris de cheveux aussi. Un pigeon précède deux touristes, un homme, puis sa femme. Tous les trois marchent à la queue leu leu. Le pigeon est très fier de leur faire visiter le jardin petit. Les pigeons reviennent plus nombreux à mes pieds. Certains nettoient leurs plumes. Ils font comme chez eux, les plantes au pied du centaure sont constellées de chiures blanches.
Bien protégé, le jardin est entouré de murs en verre, en pierre, de routes. Les plantes ont des barricades. Je sens la grande fraîcheur sous les arbres, la peau frissonne comme les feuilles. Un athlète traverse le jardin petit comme une flèche, il l’a déjà oublié. Je sors aussi. La rose dit toujours oui.
La ville petite semble encore avoir rapetissée. Au pied de la cathédrale, on dirait un petit enfant. Anciennes terreurs ressurgies de la nuit, sans doute.
Je passe du jour au noir pour rejoindre le cloître. Odeur d’égout quand la cloche sonne. Le lieu est habité par les chuchotements et les plaintes d’éléphants. Orgue improvisé par les machines sur le toit. Des ouvriers perchés quelque part derrière des bâches orchestrent la litanie. Atonale et envoutante.
Dans le cloitre carré, un autre carré de jardin petit. Le bruit des pas dans le gravier de l’allée est assourdissant. L’herbe est bien gardée. Une plante pousse en l’air. Les autres sont bien rangées, géométriques. Le reste de la végétation : mousses pourrissantes et plantes mortes en exposition. A nouveau les cloches. Toujours le dégoût. Je me heurte aux portes fermées, aux barreaux, aux fenêtres occultées par des planches. Silence. Retour des éléphants majestueux.
Solitaire, sur le gris, un tuyau de cuivre flambant neuf attire l’envie de couleur. Des vitraux répondent avec du ciel dedans. Les colonnes de pierre se veulent légères aussi. Elles sont rugueuses et froides. Pour ne pas oublier, on voit bien la grande croix de bois. Au dessus, des personnages facétieux tiennent un toit avec leur tête. Je cherche l’issue, le soleil. Je lève les yeux. Pour l’éternité, Quasimodo crie sans bruit. Je trouve un peu de lumière et d’air, sans odeur. Une fenêtre ouverte vers le soleil, très haut, invite la chaleur à entrer dans une boule de verre.
Je ressors. Je n’ai vu aucun oiseau dans le carré rangé du cloître. Dehors, j’ai plaisir à retrouver l’odeur d’épice. La peau est mise en exergue par le soleil.
La ville petite est vivante et simple. Tout n’est pas loin.
Sur la place petite, la terrasse du café tend ses tables vers moi, la vie circule ou s’installe. Le vent nous a suivis. Tout le monde a voulu venir ici : un enfant et son papy dans un portable, un livreur pour la pharmacie, les bruits de vaisselle, les voitures, les vélos. Ça crisse, ça chuinte, les portières claquent comme les rires, la musique en passant, un mégaphone incompréhensible. Les cloches avec des rires cette fois-ci. Des moteurs. Ça pue. Silence pendant trente secondes. Ma langue pétille, le diabolo menthe religieusement. Deux hommes mangent leur quatre heures : frites et autre chose qui les rend forts. Ils sont concentrés.
La place de la Libération est encerclée de bâtisses. Cerné, le vent veut s’en aller maintenant. Il cherche à sortir la tête haute en agitant le drapeau français. Rien n’y fait, il tourne en rond, s’agrippe à un sèche-linge sur un balcon rouillé, le linge bat de l’aile sur place. Il attrape tout ce qu’il peut : des moulins crécellent à toute vitesse, un papillon géant attaché aux fils électriques essaye de s’envoler, odeurs de poisson, de cigarette, de la musique… il envoie tout en l’air. Il tourne en rond sur la place petite sans trouver la libération. Retour dans le drapeau français. Je vois, comme lui, la rue étroite avec un arbre au bout. Un cow-boy arrive. Mais non, il erre sur la place petite et repart par la rue étroite avec un arbre au bout. Le vent s’est engouffré derrière lui. J’ai envie de le suivre.
L.
*
Immersion dans le réel
Traversant la place, nous croisons le petit train touristique et son guide dans le haut-parleur nasillard. L’improbable mais bien réel convoi nous suit alors, puis nous dépasse. Nous entrons dans l’enceinte du parc tandis qu’il poursuit son périple perpétuel, laissant la parole aux cloches qui sonnent, implacables, le temps qui passe ici-bas.
Nous y voilà. Le parc petit, le banc où je suis assise avec dans mon dos le bourdon agressif de la circulation, puis soudain une vague dans les arbres : le vent avec sa présence animale, réconfortante, qui se frotte aux poumons. Une dame plutôt âgée passe près de mon banc, ce bruit que font les semelles quand elles grattent le gravier. L’entrée du parc, en face, est comme une entrée en scène : celle de trois hommes et une femme. L’un deux en t-shirt vert a des lunettes suspendues à l’encolure, de celles qui ont la couleur des yeux de mouche. Puis entre, un autre homme, sportif, short noir, baskets, les yeux rivés sur son portable. Le vent toujours semble vouloir nous dire quelque chose. Peut-être à propos de notre insignifiance. C’est du vent, dit-on, comme si nous ignorions sa puissance.
Une dame, la démarche à la fois tranquille et assurée, contourne mon banc et passe devant, sa longue jupe flotte au vent tandis qu’elle s’arrête devant la boîte à lire. Quelque chose de digne et profond émane d’elle. Un pigeon se dandine, s'approche sans crainte, tandis que je surprends dans une grande façade vitrée, le vol vif des hirondelles et le coq d’une girouette qui au plus haut perché, se permet de tutoyer les nuages.
Deux jeunes femmes se sont arrêtées près d’un bac d’aromatiques, elles hument, charmées, le parfum que la menthe a laissé sur leurs doigts. De l’autre côté, un caniche gris, au bout d’une longue laisse, pisse sur un triangle de pelouse. Un gang de pigeon tourne autour de son maître dont un bouquet d’arbres ne me laisse entrevoir qu’un bras et une montre mais pas la main qui tient la laisse. Le gang de pigeons, se foutant bien des montres, se dirige droit sur moi. Me racketterait bien de quelques miettes si j’en avais. Au sol : une multitude de mégots non comestibles.
Entre une jeune fille en robe bleu roi et lunettes de soleil, nous échangeons un sourire. Puis arrivent en sens inverse, deux dames aux cheveux argentés, dynamiques. L’une d’elle dit à l’autre : « je n’ai pas vu la pub, d’habitude ils en parlent à la télé » et le vent vient balayer la suite.
Les gens, dans un mouvement quasi incessant, fendent le parc, mains dans les poches ou transportant un ou plusieurs sacs ou bras le long du corps, quand ils n’ont pas un portable greffé à la main. Sur le tour de ville derrière moi, le déplacement des autos, plus incessant encore, mais le parc a une présence qui semble cependant plus forte qu’elles. Circulation de sève. Le ciel est bleu parcouru de nuages en transhumance, les arbres bougent comme des voiles. Sur mon banc, immobile, je voyage aussi.
Un papillon blanc comme une page : apparu, disparu, au milieu des plantes. Une légère odeur de cigarette me picote les narines, des corbeaux ont quelque chose à dire. Un homme accompagné d’un autre cherche un livre dans la boîte à lire qui n’y est plus, douceur et amour semblent les envelopper.
Le parc, petit et un sentiment de paix : je pourrais rester là encore longtemps à sentir la vie tout autour de moi.
Nous quittons le parc, marchons en silence, les sens déployés, vers la cathédrale. Ses parties les plus hautes sont quadrillées d’échafaudages et bandées de toile de protection grisâtre et légèrement transparente. Curieux cocon. Le bourdonnement d’une machine, à tailler ou à poncer, met une ambiance bizarre. À l’intérieur même de la cathédrale, la résonance est impressionnante, comme la vibration futuriste d’un autre monde plutôt inquiétant, oppressant. Cela m’évoque dans un flash, un tableau de Zdzisław Beksiński.
Nous ressortons aussitôt, du côté du cloître. Cloître, claustrum, clôture. Autant je n’aime pas les clôtures, autant je n’ai jamais détesté les cloîtres. Paradoxe. Ou peut-être parce qu’ils sont comme un refuge dans la ville.
Peu de monde, les pas résonnent posément sous les voûtes des galeries, les cloches sonnent trois heures. Dans le quadrilatère central, à ciel ouvert, de mornes buis taillés en lignes droites au plus près du sol : certains gardent la marque de dévoration des pyrales. Un assemblage étrange de cartons peints, de mousse défraîchie et autres plantes coupées, sert de présentoir pour des têtes de licornes imprimées, découpées, peintes et collées elles aussi sur du carton : des enfants sont passés par là mais leur vivacité a vite disparu, n’en reste qu’un emballage vide. Au centre du quadrilatère, un cercle de buis garde des lavandes encore en fleurs, mais les lieux sentent la vieille pierre et la pisse plus que les fleurs. C’est décevant. Il manque le murmure d’une fontaine pour irriguer ce cœur lourd et asséché.
Cloître. Lieu de recueillement et de déambulation où les gens parlent à voix basse, comme si cela s’imposait, mais les travaux sur la cathédrale ne respectent pas la règle. Sur un des piliers, un dragon me montre sa croupe, sur un autre, un sphinx semble attendre pour l’éternité, une question qui ne viendra plus. La pierre noircie par le temps, porte le poids de ses chaînes. Au sol : des galets alignés, sertis dans un ciment, galets de rivière, chacun d’eux prisonnier, bien rangé, à sa place… Rêvent-ils d’être roulés à nouveau par les eaux ?
Soudain, le soleil vient illuminer une série d’arcades, les sculptures des chapiteaux prennent du relief, les figures plus haut sur la corniche deviennent plus expressives. Si elles n’étaient pas muettes, qui sait tout qu’elles pourraient nous dire ? Côté soleil, le clair calcaire du mur bas sur lequel reposent les piliers, est chaude. J’y pose la main et pense aussitôt à toutes les mains qui s’y sont déjà posées. Chaînes humaines.
Les espaces clos sont faits pour en sortir, nous retraversons la cathédrale, je lève les yeux vers la vaste coupole. J’ai toujours aimé aussi les coupoles, ce ciel fait à main d’hommes, si féminin.
Il est temps de regagner la vie urbaine. Retrouver la place en pente, toute en longueur, celle dite de la Libération et s’installer en terrasse de café. Les sens sont à nouveau surchargés d’informations. Une voix d’enfant parle fort dans le portable du grand-père. Sous la croix verte clignotante de la pharmacie, la température de la ville : 23°. Pas de fièvre, juste une petite brise légère qui fait penser au bord de mer. Un vélo a les freins grinçants et revient le petit train qui déroule sa dictée monotone à sa cargaison de touristes. Devant la terrasse, une voiture rouge s’arrête, le conducteur sort en laissant une passagère à l’avant et un chien à l’arrière. Il revient vite pour ne pas créer de bouchon, nuire à son prochain, car déjà une autre voiture est là. Voitures, voitures… Ici ce sont elles qui dominent.
Les cloches sonnent, une fois. Passent des baskets étincelants de paillettes, pantalon rayé, sac bleu éclatant, les couleurs que les humains arborent comme des plumages, que racontent-elles ?
Tasse de café, chaleur, amertume sur la langue, de celle qui réveille. Un moulin à vent géant multicolore tourne, ne tourne plus, tourne encore… Décalé. Plumages encore : veste jaune, basket blancs, veste bleu, sandales noires, les couleurs vives ne sont pas si fréquentes. « Gris et noir ça ferait chic », dit une passante à son compagnon, bribes de paroles saisies au vol. La mini-jupe en skaï beige d’une jeune femme rutile au soleil, attire l’attention. Le regard serait-il une pie ?
Une voiture blanche est heureuse de montrer qu’elle a une boite à rythme sous le capot. Des poches en plastique, des papiers, blancs eux aussi, traînent par terre, désœuvrés, s’agitent comme des pigeons. A l’autre bout de la place, un homme en t-shirt rouge assis sur des marches, parle très fort dans son téléphone et sa main libre parle aussi vivement, le rouge est une couleur énergique. Une femme passe, elle aussi au téléphone, conversations intimes qui n’ont plus rien d’intime.
Deux jeunes hommes quittent la table d’à-côté, le plus grand me sourit, un beau sourire franc. Un autre jeune homme plus bas sur la place passe avec deux grands chiens en laisse, un homme âgé avec deux petits qui trottinent librement. Évolution naturelle.
Une rue en pente débouche sans prévenir sur la place, frôlements tendus de voitures mais pas encore de tôles froissées. L’homme en t-shirt rouge s’est levé, parle toujours très fort au téléphone, puis sort de scène, remplacé par un couple de cyclistes. L’homme, casque sur la tête, la femme, casque au guidon. Le moindre détail peut en dire long, ouvre la porte à l’interprétation. Un autre couple de cyclistes, plus âgé, marche, chacun poussant son vélo.
Dès que le ballet automobile s’arrête un instant, les voix humaines aussitôt habitent les lieux, mais les moteurs reprennent vite le dessus. Peut-être pour cela que certains parlent si fort au téléphone. Un moineau sous la table, minuscule : apparu, disparu. A t-il vraiment été là ou bien était-ce le fantôme d’un passé révolu ?
Un petit chien au bout d’une laisse rouge ne cesse de se gratter, tandis que ses humains boivent un coup sans prêter aucune attention à son problème. Deux autres petits chiens, blancs et grassouillets, sont attachés à un couple, celui de la femme n’est pas autorisé à suivre sa maîtresse dans le bureau de tabac, il doit attendre sagement dehors avec le maître en t-shirt rose. Plumage pas si commun chez le mâle de notre espèce. Voilà que Mr t-shirt rouge réapparaît sur scène, il ne parle plus au téléphone, il a l’air un peu perdu. Apparu, disparu.
Il est temps de quitter à notre tour la salle d’immersion dans le réel.
C.

(photo non contractuelle, la Dépêche)


traduit de l’anglais (Ouganda) par Céline Schwaller
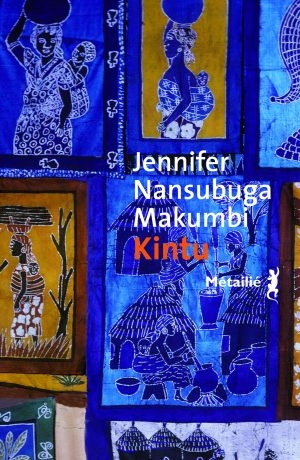
Métailié éd., 22 août 2019. 480 pages.
Ce roman est une fresque étourdissante d’une densité telle qu’il est impossible de le résumer, et d’ailleurs tel n’est pas le but de cette note, mais il faut tout de même pouvoir donner quelques pistes au lecteur. De quoi s’agit-il ? D’une histoire de famille sur plusieurs générations, trois siècles, en Ouganda, donc bien avant que ce pays ne soit arbitrairement nommé ainsi par le colon britannique, en référence à l’ethnie Ganda, occultant ainsi toutes les autres qui peuplaient cette terre.
Kintu est donc une histoire de famille, mais à vrai dire, c’est avant tout l’histoire d’un geste malheureux et de ses conséquences : la répétition transgénérationnelle d’une malédiction. La gifle d’un père, Kintu, à son fil adoptif, Kalema, lors d’une déjà difficile traversée de désert, ayant entraîné accidentellement la mort de ce dernier, qui de plus, fut vite et mal enterré par mégarde à coté d’un arbuste épineux auprès duquel on enterre habituellement les chiens.
Le roman démarre par un prologue, nous sommes en janvier 2004 à Bwayse, un bidonville situé dans une zone marécageuse au pied de Kampala. Kamu Kantu y est assassiné. Kamu Kantu est un descendant de Kintu Kidda, l'ancêtre qui a attiré la malédiction sur sa lignée. Et ce prologue laisse place au premier chapitre qui nous ramène à l’origine donc de cette malédiction : en 1750, dans la Province du Buddu, au Buganda.
Plusieurs générations vont ainsi se succéder, depuis le temps des clans, des royaumes jusqu’au début du XXIe siècle. L’histoire des individus mêlée, emmêlée à l’Histoire d’une terre sur laquelle sont venues, les unes après les autres, se greffer des religions importées et conflictuelles, dont la pas si petite dernière : la très activiste évangéliste. Une terre démembrée par la colonisation, ce qui a entre autre ravivé et compliqué les guerres tribales, et qui essaie d’avancer avec de douloureuses prothèses occidentales comme tout le reste du continent, et tous les flux migratoires consécutifs, la modernisation et la paupérisation qui va avec, les guerres encore, le sida… Y est évoqué bien-sûr la sinistrement célèbre figure d’Idi Amin Dada, mais d’un point de vue ougandais, notamment dans une discussion entre deux amis qui ne sont pas d’accord. La figure était cependant déjà suffisamment et atrocement sanguinaire, sans besoin que les fantasmes occidentaux n’en rajoutent pour en faire une caricature révélatrice de leur propre peur du « noir », tout en faisant oublier ainsi leur responsabilité dans l’instauration de ce dictateur, comme tant d’autres en Afrique.
Kintu est un roman, écrit forcément dans la langue de l’ancien colon britannique, mais c’est vraiment un roman ougandais, sans compromis.
Si la toile de fond se transforme au cours des siècles, Jennifer Nansubuga Makumbi tisse sa trame avec tant de subtilité, l'art de montrer sans dire, que ce n'est pas ce qu’on pourrait appeler une fresque historique. L’Histoire est un grand fleuve, mais ce sont les êtres humains qui sont ici au centre de la fresque, ils sont bien sûr entraînés par le courant, roulés, malaxés, modelés et parfois brisés par lui, mais, comme des galets, ils sont solides. Ils ont leur propre densité, identité, ils sont tous reliés à une montagne originelle, ancestrale et si la destinée de chacun est à la merci des événements, il existe aussi une forme de prédestination. La force du fleuve ne change rien à la malédiction qui poursuit les descendants de Kintu Kidda, génération après génération, mais cela pourrait tout aussi bien être une bénédiction, ce qui émerge de ce roman, c’est le fil qui nous relie les uns aux autres et qui traverse le temps.
Roman foisonnant, puissant, où l’on se perd facilement mais, comme les personnages, nous sommes entraînés par la force du courant. Une liste et un arbre généalogique en début d’ouvrage peuvent nous aider à reprendre pied, mais à vrai dire on n’en a pas forcément envie, car très vite, il n’est pas tant question de tout comprendre, mais plutôt de se laisser emporter et peu à peu imprégner de cette langue franche et magnifique avec laquelle Jennifer Nansubuga Makumbi nous raconte sa terre d’origine.
Un premier roman magistral.
Cathy Garcia
 Jennifer Nansubuga MAKUMBI est née à Kampala. Elle a étudié et enseigné la littérature anglaise en Ouganda, avant de poursuivre ses études en Grande-Bretagne, à Manchester, où elle vit aujourd'hui. Son premier roman, Kintu, lauréat du Kwani Manuscript Project en 2013, sélectionné pour le prix Etisalat en 2014, a reçu un accueil critique et public extraordinaire, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui lui a valu d'être comparée à Chinua Achebe et considérée comme un « classique » instantané. Elle a remporté le Commonwealth Short Story Prize en 2014 et le prix Windham Campbell en 2018. En sélection pour le Prix Médicis étranger 2019.
Jennifer Nansubuga MAKUMBI est née à Kampala. Elle a étudié et enseigné la littérature anglaise en Ouganda, avant de poursuivre ses études en Grande-Bretagne, à Manchester, où elle vit aujourd'hui. Son premier roman, Kintu, lauréat du Kwani Manuscript Project en 2013, sélectionné pour le prix Etisalat en 2014, a reçu un accueil critique et public extraordinaire, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui lui a valu d'être comparée à Chinua Achebe et considérée comme un « classique » instantané. Elle a remporté le Commonwealth Short Story Prize en 2014 et le prix Windham Campbell en 2018. En sélection pour le Prix Médicis étranger 2019.

Dors
et si tu es digne du songe
son soleil viendra poser sur ta cuisse
sa grosse gueule de chien tendre
in Chair-ville
