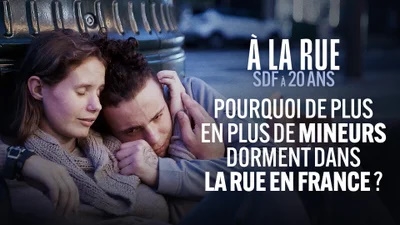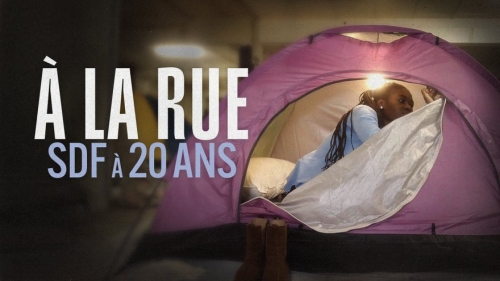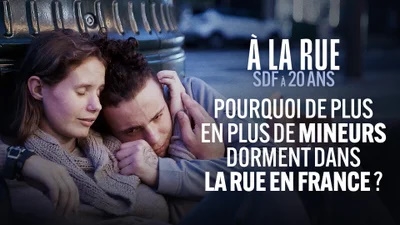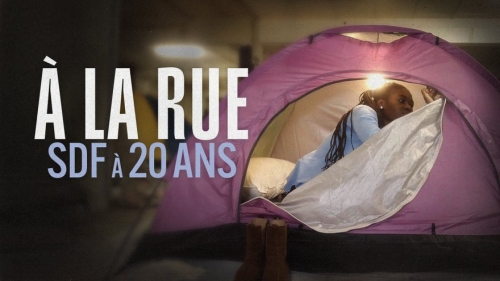
En France, 40 % des SDF ont moins de 25 ans. Leur nombre a doublé en dix ans. Le documentaire « À la rue. SDF à 20 ans », réalisé par David Simantov Lévi, donne la parole à quelques-uns de ces jeunes en galère, trop souvent invisibles.
à voir ici : https://www.france.tv/slash/a-la-rue-sdf-a-20-ans/7682373-a-la-rue-sdf-a-20-ans-le-documentaire.html
"Jordan, Ludivine, Benjamin, Sara, Richard et Fouss ont entre 16 et 24 ans. À l’âge du bac et des premières amours, ils vivent à la rue, en squat, en hébergement temporaire et connaissent la trêve hivernale. Le journaliste David Simantov Lévi les raconte dans un documentaire choc diffusé sur Slash, la plateforme de France Télévisions.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux jeunes sans-abri ?
Le nombre de personnes sans abri explose. Je ne suis pas certain que le grand public en ait conscience. Il y a quinze ans, aucun enfant ne dormait sur le trottoir.
Aujourd’hui, ils sont des milliers. Cette année, plus de 900 SDF, dont plusieurs dizaines de nourrissons, sont décédés, selon le Collectif les Morts de la rue. C’est le signe d’une société malade, incapable de prendre soin des plus vulnérables. Cela dit quelque chose du délitement des liens sociaux, des failles de l’aide sociale à l’enfance, de l’explosion de la consommation de drogue, et de notre incapacité à accompagner correctement les personnes en souffrance psychique. Il était essentiel pour moi de réhumaniser ces personnes, de montrer qui elles sont. Peu de gens osent aller vers eux, leur parler ou simplement les regarder. Filmer, c’était une façon de leur rendre ce regard qu’on leur refuse.
Vous indiquez dans le film que 40 % des SDF ont moins de 25 ans.
Les jeunes sont surreprésentés dans la rue, car entre 18 et 25 ans, il existe très peu d’aides sociales. À cet âge, on reste fragile, et le logement est un socle essentiel pour se construire. Certains n’ont besoin que d’un petit coup de main pour s’en sortir et révéler leur potentiel. Des artistes talentueux ont passé des années à la rue. Ce serait dramatique de laisser les futurs Sorj Chalandon ou Corinne Masiero croupir sur un trottoir.
C’était un tournage au long cours et incertain. Vos témoins étaient susceptibles de se volatiliser…
J’ai suivi Sara et Richard pendant près d’un an et seulement un mois avec Jordan. À chaque tournage, je savais que cela pouvait être la dernière fois que je les voyais. J’ai perdu souvent leur trace, il fallait plusieurs jours de recherche pour les retrouver. Même quand je leur donnais un téléphone pour garder le contact, ils se le faisaient voler très vite.
Quel a été votre dispositif technique pour ce film ?
J’ai tourné seul. Il était impossible de planifier quoi que ce soit, ce qui rendait la collaboration avec un chef opérateur ou un ingénieur du son irréaliste. C’était un vrai défi de tourner dans des conditions aussi compliquées. La concentration et la vigilance doivent être constantes, et le moindre imprévu devient un casse-tête. J’avais un équipement minimaliste pour rester mobile et discret. Ce dispositif très léger a été essentiel : il me permettait d’être réactif et de réduire la distance avec les sujets.
Être diffusé sur Slash a-t-il un sens particulier pour ce documentaire ?
Je suis très attaché à l’audiovisuel public. Ce projet aurait eu plus de mal à exister ailleurs. La liberté de création qu’offre Slash est quasi unique dans le paysage audiovisuel français aujourd’hui. J’avais remporté leur concours « Filme ton quartier » en 2022, ce qui m’a permis d’obtenir un premier soutien pour ce projet. Et d’un point de vue éditorial, Slash aborde des questions essentielles pour les jeunes.
À titre personnel, que vous a apporté cette enquête ?
Ces jeunes m’ont donné beaucoup de force. C’était une expérience de vie totale. Pour la séquence dans le squat de Richard, j’ai dormi sur place pour filmer son réveil. J’ai eu vraiment peur ce soir là : l’immeuble menaçait de s’effondrer et certains squatteurs étaient beaucoup moins bienveillants. J’ai fait l’expérience de cette vulnérabilité extrême. On a parlé toute la nuit. Il m’a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne. Ce soir-là, il n’y avait plus de caméra, plus de rôles, juste deux humains qui se parlent.
Comment s’est passé le retour à votre quotidien ?
J’ai eu du mal à me réadapter à mon milieu social. Le même jour, je pouvais passer d’une journée dans la rue à un événement mondain : le contraste était insupportable. Il n’y avait aucune séparation entre ma vie professionnelle et personnelle, car tout se passait dans des quartiers que je fréquente au quotidien. J’ai réalisé à quel point on vit dans des mondes parallèles qui ne se croisent jamais. Je me suis aussi heurté à une violence que je ne soupçonnais pas : celle de la rue, mais aussi celle de certains SDF, prêts à tout pour vous voler ou simplement vous faire payer votre statut de privilégié. Cela m’a rendu nerveux pendant des mois, comme si j’étais encore en vigilance permanente. La rue laisse une trace physique et mentale, même quand on n’y dort pas."
(Source : L'Humanité, entretien réalisé par Catherine Attia-Canonne, 05 nov. 2025)