Le Petit Chaperon Rouge

Par Sir John Everett Millais

par Gustave Doré

par William M. Spittle
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Par Sir John Everett Millais

par Gustave Doré

par William M. Spittle
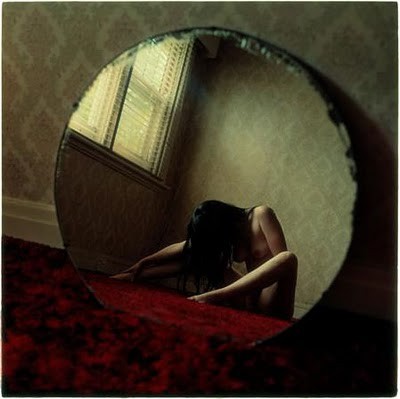
Série The other side, 2002

Série Reflecting skin, 2012

Série Whitestain, 2011
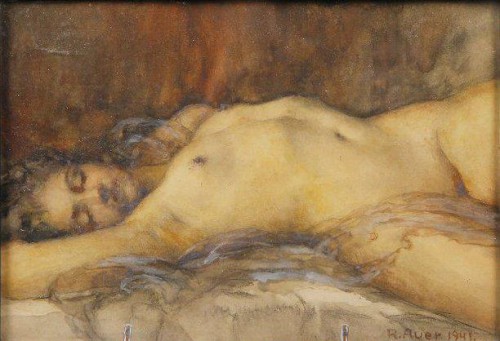


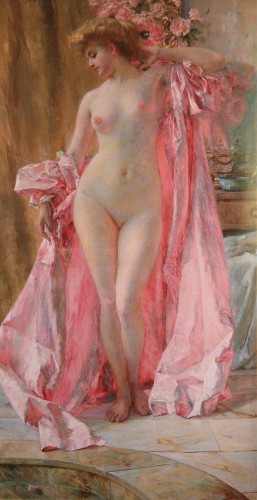

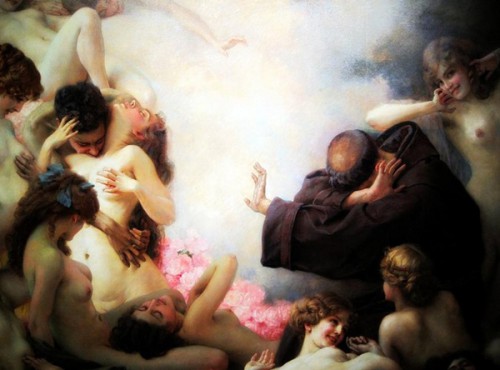
Robert Auer, né en 1873, décédé 1952 était un peintre croate, qui a peint plus de 150 portraits et des nus et autant de compositions symboliques.

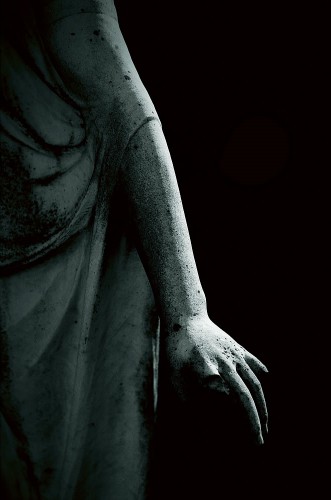
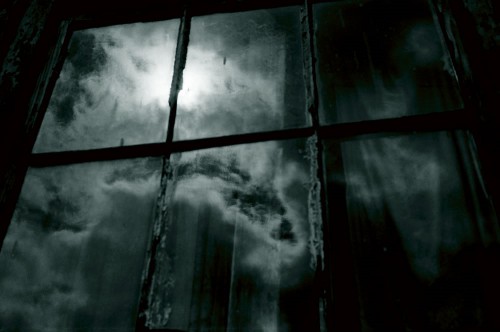
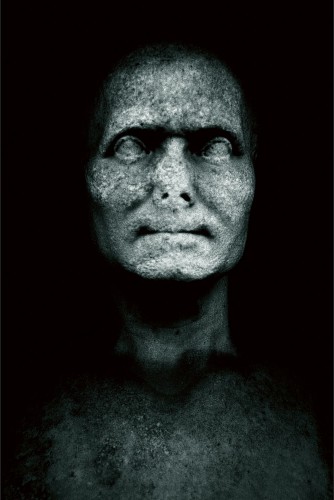



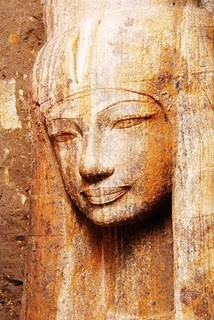



de la série As above so below, 2010

de la série Wormwood, 2007
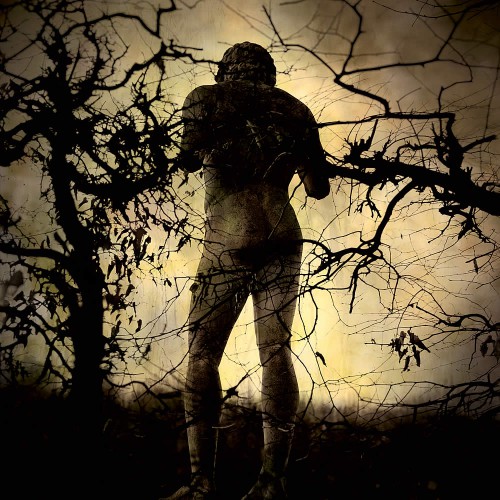
De la série Ivy, 2009

De la série The Fall, 2004
Là-Bas [Down There], 2012 une vidéo de Fabrice Bigot et Jane Burton
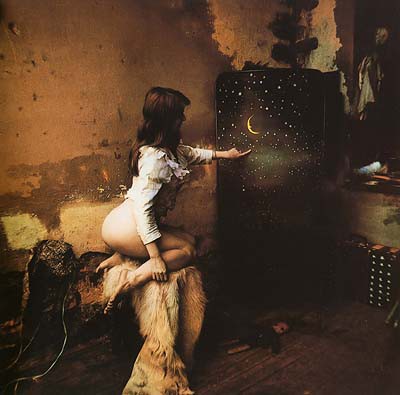
This star is mine, 1975

Wich star is mine, 1975
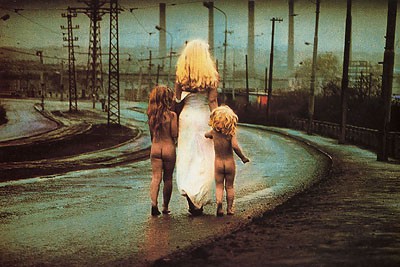


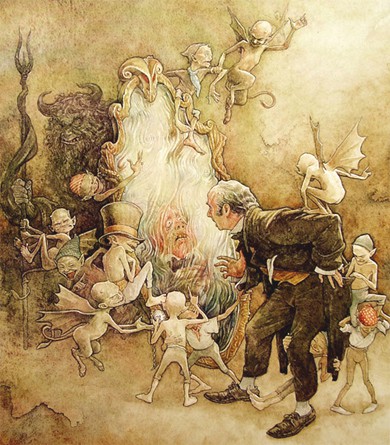
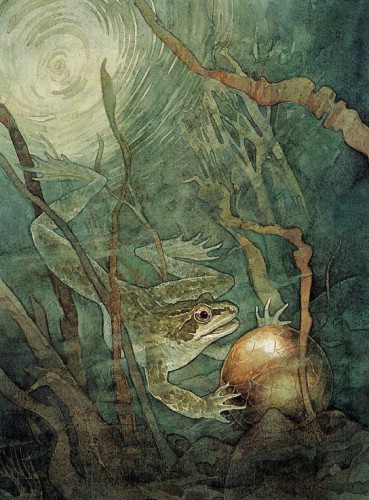


Patrick James Lynch né le 2 mars 1962 et connu sous sa signature P. J. Lynch, est un illustrateur jeunesse irlandais.

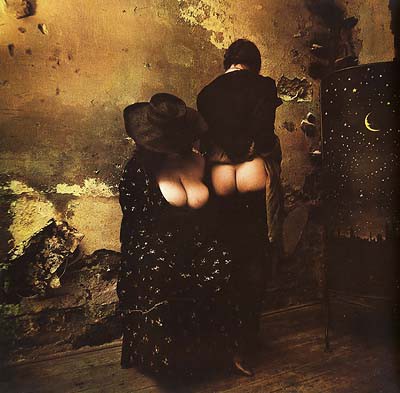
2 big for U, 1981
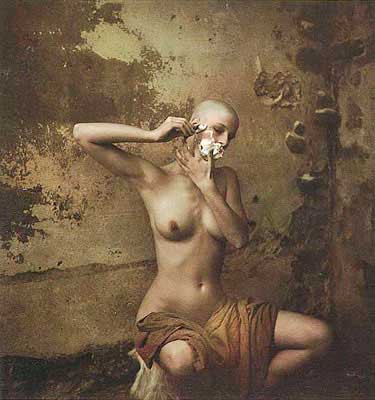
Gabi shaves herself, 1982

The Martyr of love, 1989
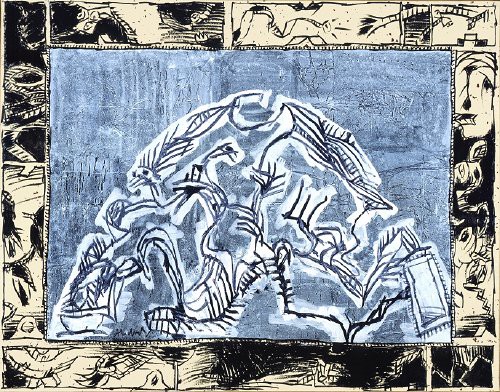
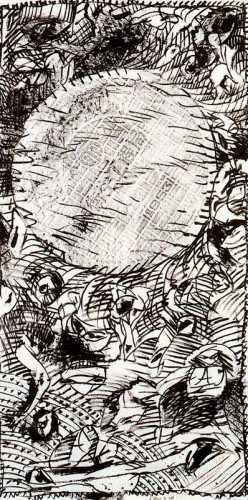
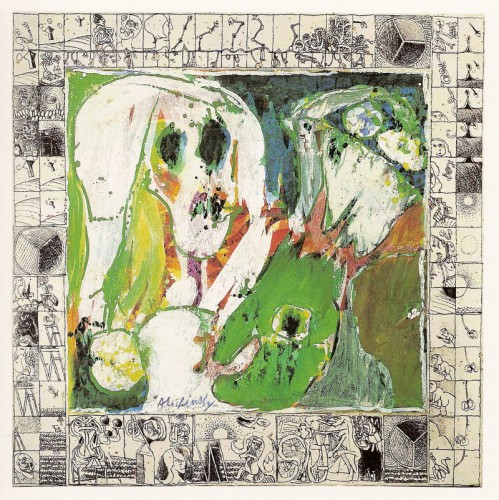

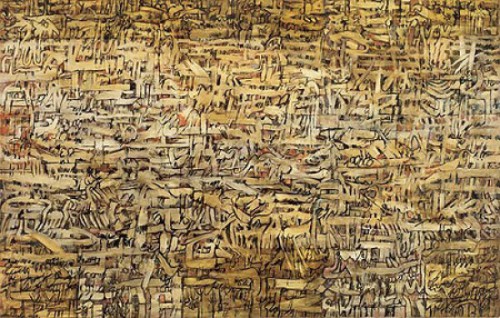
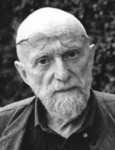 Pierre Alechinsky, né le 19 octobre 1927 à Schaerbeek, est un peintre et un graveur belge, qui réunit dans son œuvre expressionnisme et surréalisme. Le père de Pierre Alechinsky est un juif russe et sa mère est wallonne. Tous deux sont médecins. Dans les années 1930, Alechinsky étudie à l'école Decroly à Bruxelles, il est un étudiant modéré. On oblige l’enfant gaucher à écrire de la main droite. La gauche, sa meilleure main, les éducateurs la lui laisseront pour les travaux « de moindre importance » : le dessin... De 1944 à 1948, il étudie l'illustration du livre, la typographie, les techniques de l'imprimerie et la photographie à l'École nationale supérieure d'Architecture et des Arts visuels de La Cambre à Bruxelles. C'est pendant cette période qu'il découvre l'œuvre d'Henri Michaux, de Jean Dubuffet et des surréalistes
Pierre Alechinsky, né le 19 octobre 1927 à Schaerbeek, est un peintre et un graveur belge, qui réunit dans son œuvre expressionnisme et surréalisme. Le père de Pierre Alechinsky est un juif russe et sa mère est wallonne. Tous deux sont médecins. Dans les années 1930, Alechinsky étudie à l'école Decroly à Bruxelles, il est un étudiant modéré. On oblige l’enfant gaucher à écrire de la main droite. La gauche, sa meilleure main, les éducateurs la lui laisseront pour les travaux « de moindre importance » : le dessin... De 1944 à 1948, il étudie l'illustration du livre, la typographie, les techniques de l'imprimerie et la photographie à l'École nationale supérieure d'Architecture et des Arts visuels de La Cambre à Bruxelles. C'est pendant cette période qu'il découvre l'œuvre d'Henri Michaux, de Jean Dubuffet et des surréalistes
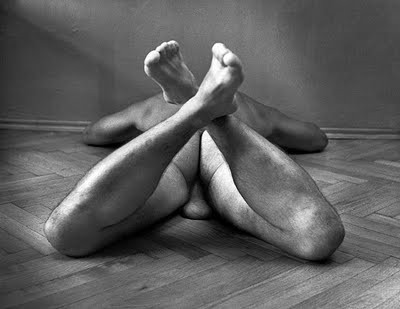
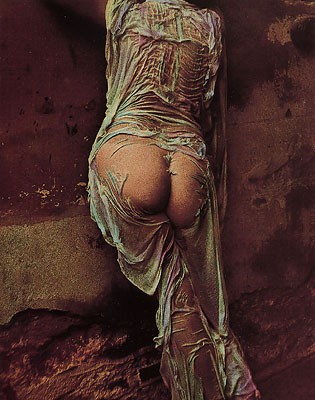
Pavla Poses for The First and Last Time, 1978
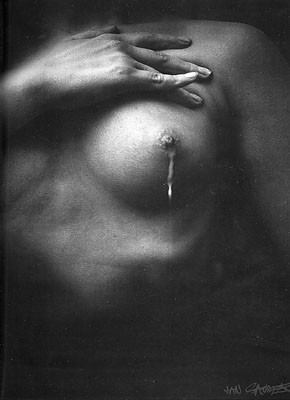
Motherhood, 1986