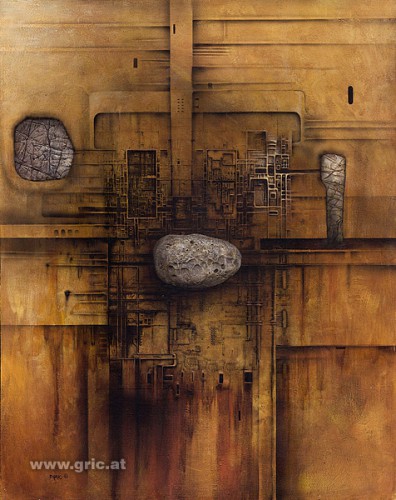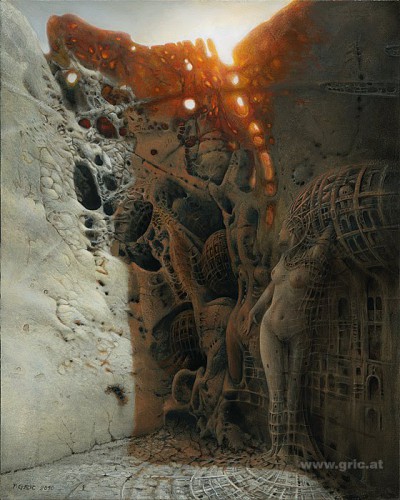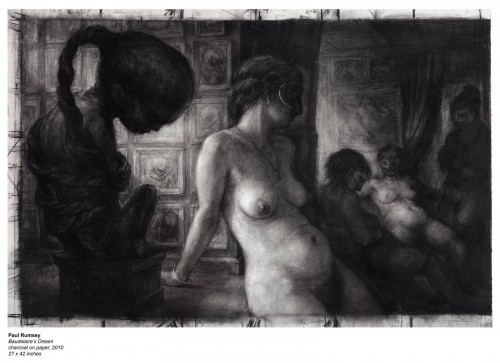Issei Suda

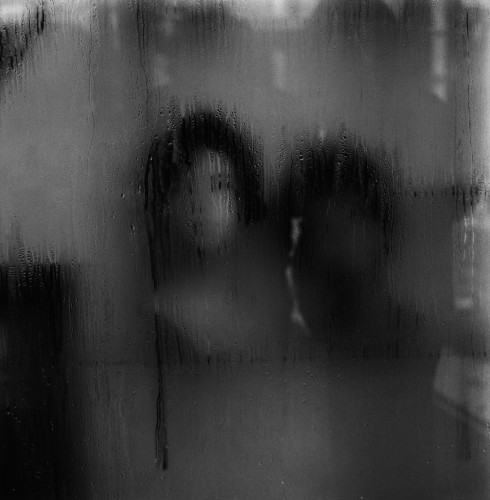

Issei Suda est un photographe japonais. Né à Tokyo en 1940, Suda est diplômé de l'école de photographie de Tokyo en 1962. De 1967 à 1970, il travaille en tant que cameraman de la compagnie théâtrale Tenjō Sajiki, auprès de Shūji Terayama.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

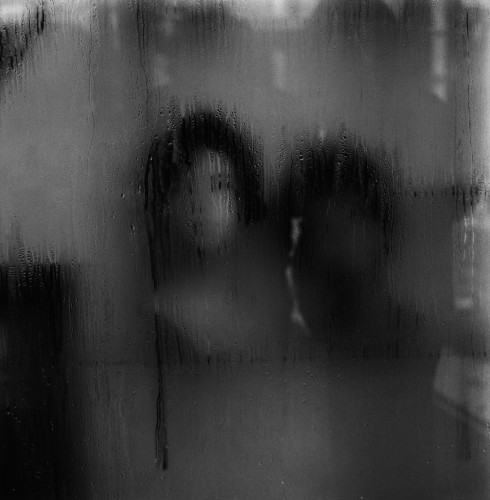

Issei Suda est un photographe japonais. Né à Tokyo en 1940, Suda est diplômé de l'école de photographie de Tokyo en 1962. De 1967 à 1970, il travaille en tant que cameraman de la compagnie théâtrale Tenjō Sajiki, auprès de Shūji Terayama.


Je marche. J’écoute.
Secret du ricochet. Beauté de la chute.
Sève des reins. Sang de tourbe.
Chemin de cornes et de pluie.
Cg in Fugitive

Il se trouve, hélas, que nous n'avons plus rien à nous dire et que nous sommes des bulles qui nous nous éloignons toujours plus les unes des autres, quand nous n’éclatons pas tout simplement, parce que c’est l’heure de la dissolution, du retour au grand tout cosmique. Aimer, être aimé, séduire, être séduit, nous unir, nous accoupler, nous séparer, chercher à s’accoupler de nouveau, parce que seuls ces bateaux là nous rassurent dans le vide de nos existences. Bulles. Cellules. L’herbe verte dans le pré du voisin est génétiquement modifiée.
Cg in A la loupe, tout est rituel

Des cabanes tremblantes
Sur les dunes
Des ruisseaux de thé
Et la nuit mouillée
Troublante au-delà des digues
cg 2013

Les singes font des signes
mais les cygnes font-ils des singes ?
cg in Bonzaïs hallucinogènes

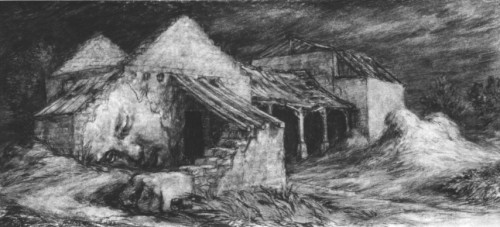
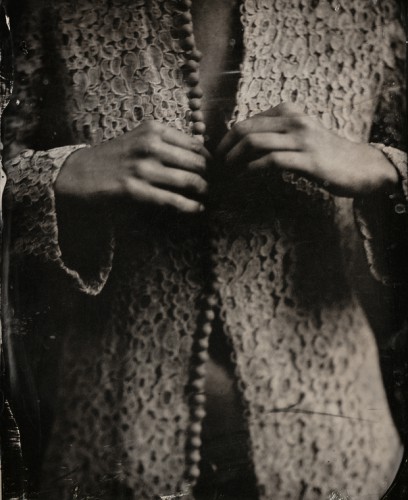
AU BOUT DU ROULEAU
au bout du rouleau
je cherche tes doigts
sur l’envers de ma peau
au bout du rouleau
ma vie se lasse
voudrait un autre tempo
au bout du rouleau
je m’en vais
disparais
sans même
un dernier mot
in Mon collier de sel

(à partir d'une vieille photo, auteur inconnu)

MON LOUP D’AMAZONIE
A Punch
Il y avait un ruisseau au fond du potager, l’Amazone, et au-delà c’était la forêt, la grande, la vraie. Et puis toi et moi, à la belle aventure. Toi, chien loup noir et fauve et moi, intrépide héroïne chaussée de caoutchouc vert.
Le pont d’allumettes franchi, nous glissions dans le lit sauvage du ru, pour remonter son cours et pister ses secrets, humer l’acidulé des pommes humides, le frisson phosphorescent d’étoiles grenouilles sur l’argile moussue.
Nous apprenions la langue de l’eau, entre le chuchotis des rives vierges, les périlleux méandres et l’obscur ensorcellement des racines.
Nous galopions, bondissions entre ronces et lianes, nous enfoncions au plus profond de la mer végétale pour connaître soudain la joie ivre et farouche de se savoir enfin perdus. Quand Réel et Imaginaire tissaient le Temps du Jeu alors TOUT devenait possible.
Je m’abandonnais heureuse à cette magie du monde qui m’a tout enseigné.
Et toi beau loup fidèle, sans faute toujours, à la civilisation tu me ramenais.
Civilisation dont l’entrée se situait à hauteur exacte
De la première rangée de carottes du potager.
2005
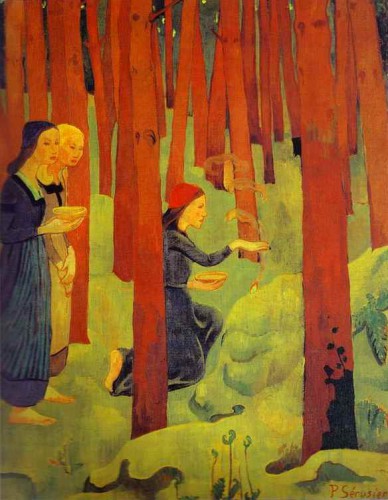
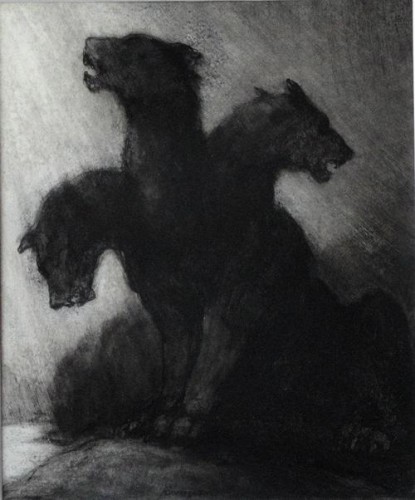
Les orfèvres des nerfs savent travailler la poussière et la rouille dans la craquelure des crânes. Fièvre des déserts visionnaires. Lunes aveugles, dollars putassiers. Brut teinté de grenades dans lesquelles mordent les nomades. Les illusionnistes écorcent les corps après ébullition, dissimulent les noyaux instables au fond des failles.
La sentinelle, les paupières lourdes de mélopées, ouvre ses cuisses solaires découvrant l’ourlet, vagin mystérieux léché par l’écume, éblouissante et fugace semence.
Son enfant aura trois têtes.
cg in Le poulpe et la pulpe (Cardère 2011)