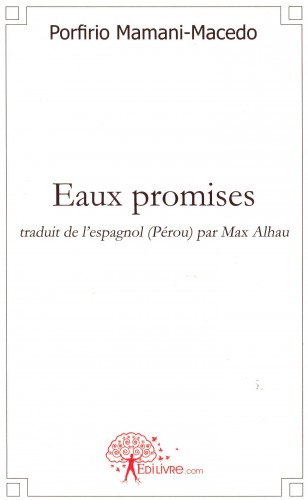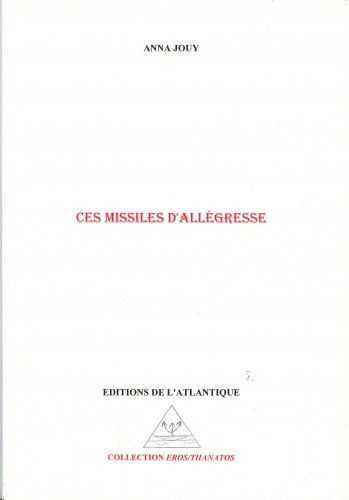Eaux promises de Porfirio Mamani-Macedo
traduit de l’espagnol par Max Alhau
Edilivre 2011 – 44 pages – 10 €
***
Mon vieux visage amoureux continuera d’être orphelin de tout, quelque part où personne ne se souviendra de lui. (…) Maintenant, je cherche seulement un visage dans la neige, un signe, une étreinte pour apaiser l’hiver de mon être.
Ainsi débute Eaux Promises de Porfirio Mamani-Macedo.
Exil, errance, solitude, boue, poussières, vent, fleuve, rêve et mémoire, et comme une marche forcée qui n’arrivera jamais nulle part, car nulle issue possible à la douleur et à la perte imposée par l’exil.
Le premier recueil de Porfirio Mamani-Macedo que j’ai lu il y a quelques années, lorsque j‘avais publié Porfirio dans la revue Nouveaux Délits (n°5, mai 2004), c’était Voix au-delà des frontières, dans lequel il raconte son arrivée en Espagne, après avoir quitté le Pérou, et cette terrible et double peine de celui qui est à la fois l’étranger en territoire inconnu et l’exilé d’un pays aimé mais désormais interdit. Dans Eaux Promises, Porfirio reprend ce thème si important de son vécu, toute la douleur associée et se fait porte-voix de cette condition d’exilé, errant, clandestin, fuyard, de tout temps et de partout. Ode universelle à ceux, toujours plus nombreux, qui ne sont sur cette terre plus que des ombres en transit.
Seules tes traces diront que tu es passé
Je retrouve dans ce recueil cette belle voix, amoureuse de beauté et de fraternité, hantée par la déchirure et une immense solitude.
Combien nous désirons la pluie en chemin, combien nous cherchons l’amour, seuls, parmi les heures interminables lorsque nous traversons un pont, un parc, une montagne pour voir ce qu’il y a de l’autre côté !
Cette douce voix d’homme qui implore que cesse enfin la violence.
La parole, pas la guerre. La voix, pas les armes. Plus de bruit, mon âme est brisée. Plus de chemins à travers les montagnes de la haine et de la douleur.
Porfirio Mamani-Macedo nous renvoie l’écho de ce vide vertigineux qu’est celui de l’errance, le désert sans consolation du déracinement et la si frêle béquille de l’espoir.
Faisant route vers des terres inconnues, des hommes et des femmes, malheureux, vieux, malades, doivent encore marcher attendant le soir ou l’aube qui les sauvera.
Arrachés à leur vie comme des pierres par un fleuve en furie, il leur faut marcher, marcher toujours, fuir l’intolérable, l’injustifiable, l’atroce.
Que n’éclate plus, ô mon dieu, le feu dans la chair, que l’on n’entende plus le bruit d’un homme tombant, le corps criblé.
(…)
Que d’enfants sans lumière sur les chemins ! Que de cadavres serrés dans la terre comme une boue maudite ! O vent, éloigne ce siècle en ruine rempli de honte et de folie !
Il faut marcher encore et encore, hommes, femmes, enfants, jetés hors de leur foyer, de leur pays, poussés sur les routes, broyés contre les frontières, dispersés dans les brumes de contrées où ils ne sont pas les bienvenus, les yeux emplis de peur et le cœur en miettes.
Sur le chemin glissant et étroit, ombre après ombre, s’avancent les pas des exilés.
(…)
Etire ton cou, cygne enchaîné, pour voir ceux qui s’éloignent. Le chemin qu’ils suivent ne les conduits vers aucune porte.
(…)
Que te dire, cloche ancienne, en ce soir de printemps, car ce ne sont pas des ombres qui passent mais des plaies ouvertes qui cheminent ; ce sont des rêves brisés que les vents obscurs soufflent.
Et Porfirio Mamani-Macedo aussi, continue à marcher et à maintenir vive la mémoire, à ressasser, car il le faut, le souvenir.
Qu’elle est loin la mer que je ne vois pas ! Qu’elle est loin la vieille montagne où je suis allé m’asseoir après un après-midi interminable ! Qu’elles sont loin ces aubes sans mère, sans fruit, sans café !
(…)
Quelque part je resterai, vieille montagne. Toi qui m’as vu franchir la frontière comme le vent entre la pluie, préserve mon silence dans un bois.
Car le souvenir, aussi douloureux soit-il, ne doit pas s’effacer, car à l’auteur comme à tous les exilés, la mémoire est tout ce qui leur reste, le souvenir, leur seul et unique bagage.
Tu avances, absorbé, silencieux, tu te consumes jour après jour. Tous les tiens ne vont pas avec toi. Peut-être un jour les rencontreras-tu, peut-être un jour te rencontreront-ils, peut-être ne vous rencontrerez-vous jamais.
Et Porfirio Mamani-Macedo marche et mâche le chagrin et l’indéfectible solitude.
Les pas gris que je fais et qui m’attendent, rue après rue, sont des épines qui emmêlent mon âme.
(…)
Car malgré l‘appel des Eaux Promises,
Il n’y a pas de rivages sur cette mer que je traverse. Toute parole prend l’eau et tout écho s’éloigne avec les vents. Il pleut des souvenirs oubliés, des chemins que l’on ne parcourra plus, des paysages dont mes yeux noirs ne pourront plus jouir.
Nulle issue à l’errant sinon de marcher encore et encore et la boucle incessamment est bouclée autour du cou de l’espoir.
Un spectre m’arrête derrière chaque porte. Là, j’attends encore que tu sortes ou que tu arrives, voix humaine, pour consoler mon âme.
Cathy Garcia
 Porfirio MAMANI MACEDO est né à Arequipa (Pérou) en 1963. Docteur es lettres à la Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son diplôme d’avocat à l’Université Catholique Santa María, et a fait ses études de Lettres à l’Université Nationale de San Agustin (Arequipa).
Porfirio MAMANI MACEDO est né à Arequipa (Pérou) en 1963. Docteur es lettres à la Sorbonne Nouvelle. Il a obtenu son diplôme d’avocat à l’Université Catholique Santa María, et a fait ses études de Lettres à l’Université Nationale de San Agustin (Arequipa).
Ses blogs :http://porfiriomamanimacedo.blogspot.com/ et http://letrasdeporfirio.blogspot.com/
Bibliographie :
La Luz del camino. (poésie) Lima, Hipocampo Editores, 2010.
Tres poéticas entre la guerra civil española y el exilio (essai): Miguel Hernández, Rafael Alberti, Max Aub. Lima, Fondo Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 2009
Lluvia después de mi caída y un Requien para Darfur, (poésie) Lima, Hipocampo Editores, 2008.
La sociedad peruana en la obra de José María Arguedas (essai), Lima, Fondo Editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 2007
Représentation de la société péruvienne au XXème siècle dans l'œuvre de Julio Ramón Ribeyro. (essai)Paris, Editions L'Harmattan, 2007
Avant de dormir,(nouvelles) L’Harmattan 2006.
Poème à une étrangère. (poésie) Editinter, 2005.
Un été en voix haute, (poésie) Trident neuf, 2004.
Voix au delà des frontières, (poésie) L'Harmattan 2003.
Flora Tristan : La paria et la femme étrangère dans son œuvre, (essai) Editions L'Harmattan, 2003.
Voix sur les rives d'un fleuve, (poésie) Editions Editinter, Paris, 2002.
Le Jardin et l'oubli, (roman) Editions L'Harmattan, Paris 2001.
Au-delà du jour, (poèmes en prose) Editions Editinter, Paris 2000.
Début de la promenade, (poésie) Editions Encres Vives, France.
Les Vigies (nouvelles) Editions L’Harmattan, Paris 1997.
Dimanche, (récit) Editions Barde la Lézarde, Paris 1995.
Ecos de la Memoria, (poésie) Editions Haravi, Lima, Pérou 1988.