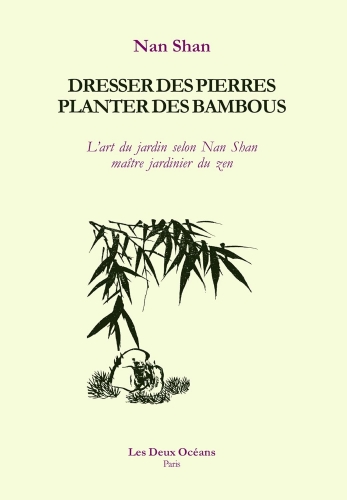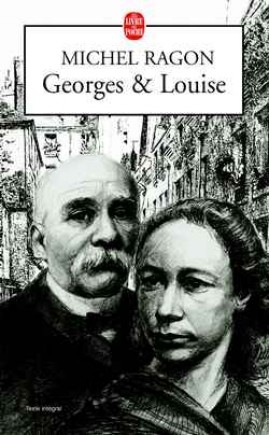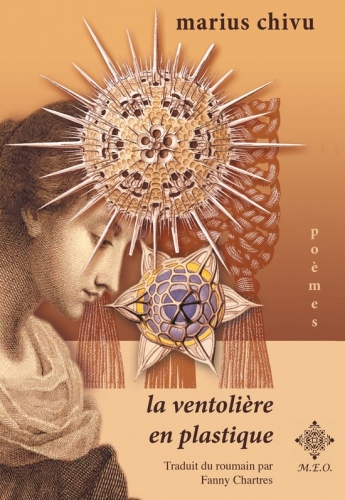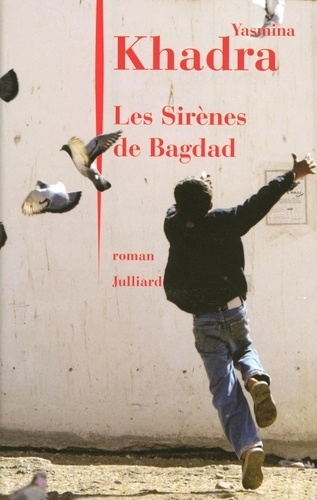Les vertiges de la forêt de Rémi Caritey
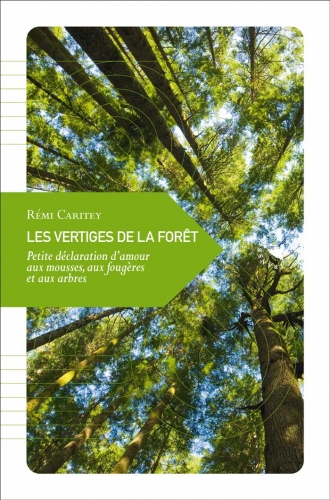 (...) Je me grise de l’ondulation puissante, de la souplesse organique du tronc, comme agrippé au col d’un troll endormi, dodelinant d’un sommeil antique. Je fais corps avec cette pulsion de rêves archaïques ; ce faisant, je reviens peut-être à quelque chose du début de la vie, quelque chose d’avant la naissance, un balancement calme, irrépressible, continu et consolateur.
(...) Je me grise de l’ondulation puissante, de la souplesse organique du tronc, comme agrippé au col d’un troll endormi, dodelinant d’un sommeil antique. Je fais corps avec cette pulsion de rêves archaïques ; ce faisant, je reviens peut-être à quelque chose du début de la vie, quelque chose d’avant la naissance, un balancement calme, irrépressible, continu et consolateur.
(…) Un manteau d’humanité, qui réchauffe les solitaires bercés par les voix de la Création, relie ceux qui se mettent à l’écoute des rêves de la Terre, nous renvoie à un sanctuaire intérieur, un lieu de ravissement, où les désirs sont sans objet parce que c’est la Terre qui nous possède, et de notre abandon à cette possession jaillit une paix totale.
(…) Tout faisait appel à la capacité non pas de saisir, mais d'honorer et de rejoindre.
(…) Ce creuset de l’animisme et du sacré, je rêve d’une écologie politique qui oserait s’y refonder.
(…) Marcher dans la nuit sous la lune, s’approcher d’une clairière en croyant voir les reflets d’un étang et découvrir un cercle de graminées reliées au firmament : voilà qui renvoie à la pulsation profonde du monde et qui réveille le sauvage en nous. Et que veut-il ce sauvage ? Le privilège de la lenteur. Vivre au rythme de ses rêves. Célébrer la beauté de toute chose. Mesurer son action à l’aune de son corps, de son âge, de la simplicité de ses besoins. Laisser ses pensées suivre leur cours, grandir, s’épurer, avec pour seul stimuli les voix de la nature. La forêt nous immerge dans un milieu vivant, totalement animé. Anima, l’âme des choses. Un milieu qui nous éloigne de la pulsion de conquête et nous rapproche d’une pulsation vitale, universelle.
(…) Et comme ces hommes élevés par les forêts ancestrales il nous faudra, au sortir de notre traversée des pins, un temps infini pour retrouver un rythme intérieur à peu près compatible avec la marche du monde, et un semblant d’intérêt pour le tumulte.
Transboréal éd. 2018
Né à Remiremont en 1957, Rémi Caritey conserve l’empreinte de la forêt vosgienne, dont il avait ressenti enfant toute la magie. Lycéen, il pratique la photographie et le tirage en noir et blanc. Il acquiert une caméra 8 mm et met en scène jardins, montagnes et amis. Pour ne pas porter d’uniforme en forêt, il écarte le métier de garde forestier et, afin de ne pas entrer en photographie dans un cadre scolaire, il opte pour des études d’architecture intérieure aux Beaux-Arts de Nancy. En 1977, diplôme en poche, il reprend son cheminement photographique en toute liberté, y compris celle d’une année sans déclenchement afin de tester le renoncement à sa passion.
Ces années de formation autodidacte à la photographie et au cinéma sont aussi celles des premières saisons de récolte de graines d’arbres, pour lesquelles Rémi Caritey fréquente les plus beaux massifs répertoriés en tant que peuplements semenciers par l’Office national des forêts. Ces récoltes s’effectuent à la cime des arbres et, outre le plaisir – et le danger – d’escalader des géants, sont prétexte à des bivouacs prolongés, que ce soit dans les Landes, les Pyrénées, le Massif central, le Luberon, le Bassin parisien, le Jura ou les Vosges, ou bien en Alsace et en Normandie? Des journées entières dans les arbres !
Rémi Caritey découvre l’Afrique en 1981, par le biais d’une amie sociologue au Sénégal. En 1985, il applique un regard ethnographique sur son village natal et réalise une série de portraits d’automobilistes lors du passage à la station-service – vue comme l’oasis des pays développés. Cette série d’images, « Station en service », donnera lieu à plusieurs publications et expositions. Photographe pour Libération à cette date, il prend les portraits du jour et couvre l’actualité socioculturelle. Il réalise par ailleurs L’Autocar qui, s’attachant aux pas de ses protagonistes, révèle le miroir aux alouettes d’un voyage organisé en Thaïlande. En 1989, il s’éloigne du journalisme pour renouer avec la lenteur en voyage, et s’établit pour un an dans un village de Casamance, à Diakène-Diola, où il installe son laboratoire. Dans un studio de toile, en lumière du jour, il photographie ses voisins et les objets de leur vie quotidienne. Ce travail, « Eebiteye », sera exposé en 1990 et publié dans L’Autre Journal ainsi que dans Le Monde diplomatique.
De retour dans les Vosges, Rémi Caritey renoue avec le rythme des bivouacs saisonniers en forêt en vue de récolter les graines des arbres, alternant avec des séjours au Sénégal où il retrouve les habitants de Diakène-Diola, dorénavant réfugiés à Dakar. Entre 1990 et 1994, il produit en 16 mm ?il-Village, un journal d’exil qui relie l’Afrique et les Vosges. En 1996, il s’installe en Côte d’Ivoire, où il photographie les chantiers de la Société de développement des forêts. Il réalise aussi Gardiens de la terre pour lequel il fréquente la confrérie des chasseurs dozos afin de présenter comment les communautés s’insèrent avec sagesse et respect dans leur environnement naturel : une insertion contrariée par l’administration qui se sent menacée par cette autorité traditionnelle à laquelle elle prétend se substituer. Dans Hippotrague, il filme en outre la création du parc national du mont Sangbé, pour laquelle se pose la question de délocaliser cinq villages, un parc national se devant d’être inhabité. C’est un troublant dossier que celui de l’application d’une stricte réglementation à un territoire de vie : exclure l’humain de la nature pour mieux la préserver !
Les troubles politiques qui secouent la Côte d’Ivoire à partir de 2000 mettent un terme à tous les projets de Rémi Caritey. Son rapatriement en France signifie un retour aux forêts et aux récoltes saisonnières, quoique sa figure de l’arbre se soit enrichie des visions africaines. Son activité professionnelle multimédia s’articule désormais autour de l’écosystème forestier. En 2005, il rencontre José Le Piez, le créateur des Arbrassons, et esquisse le film L’Arbre en nous sur ces pièces d’arbre sculptées qui, caressées, résonnent d’harmoniques et évoquent l’instrument sacré qui apaise les génies de la forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Vertiges de la forêt, paru en 2011, est né de cette longue fréquentation des forêts en vue de la récolte de graines. De ces récoltes de graines de chêne, douglas, épicéa, érable, mélèze, pin maritime principalement, sont issus des milliers d’hectares de feuillus et de résineux qui nous rejoindront par le biais de l’architecture, de la menuiserie, de la lutherie et, peut-être même, sous la forme du papier de ses prochains livres.
En 2012, Rémi Caritey expose à Andrésy, sur l’île Nancy située à la confluence de l’Oise et de la Seine, dans le cadre de « Sculpture en l’île ». Il y présente « Filigrane », une série de photographies qui relient la forêt fluviale aux sylves tropicales. Il publie également dans le catalogue de cette exposition plusieurs portraits d’arbres insulaires, choisis pour leur singularité. Ce travail d’écriture se poursuit les années suivantes et aboutit, en 2017, à l’édition par la ville d’Andrésy d’un recueil de textes, Le Sentiment de l’arbre, offert aux visiteurs. Ce recueil est au format d’une carte géographique, sur laquelle on retrouve l’emplacement des « arbres singuliers » du site. On découvre également, dans les plis de cette carte, des graines récoltées par l’auteur à l’automne 2016, qui font des visiteurs de l’île des agents de dissémination de cette forêt insulaire.
En 2017, Rémi Caritey publie également, chez Gérard Louis, Un arbre couleur pourpre, Quatre saisons à la Pépinière. Né d’une rencontre avec les jardiniers de la ville de Nancy, ce journal d’un arbre est une invitation à cheminer dans l’arborescence d’un hêtre pourpre historique, au cœur du parc nancéen de la Pépinière. En 2020, à la suite d’une résidence de territoire à la maison Laurentine, à Châteauvillain, en Haute-Marne, il publie La Forêt heureuse aux éditions Liralest/Le Pythagore. Il préside depuis 2023 l’association Préservons l’environnement du col des Hayes, qui vise à faire en sorte que soit prise en compte la réalité des bouleversements climatiques dans les projets d’aménagement du massif vosgien, en particulier en ce qui concerne la réouverture d’une carrière de granit dans le périmètre d’un espace naturel sensible.
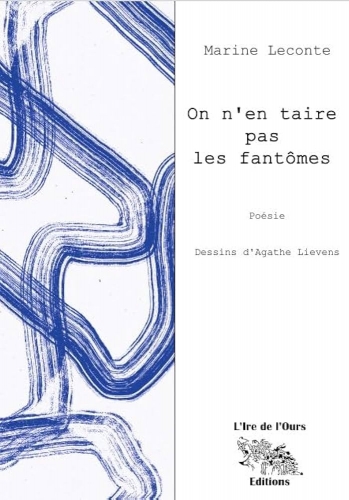
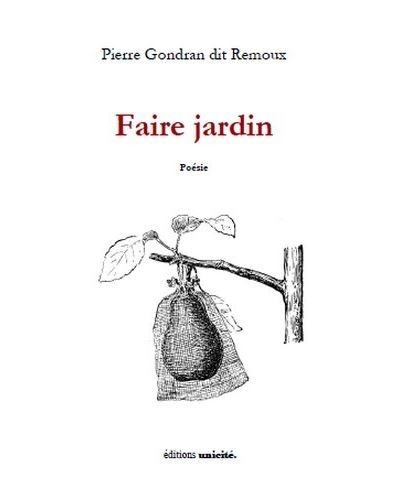 Faire jardin
Faire jardin Pierre Gondran dit Remoux est né en 1970 à Limoges. Ingénieur agronome de formation, ce Parisien d'adoption n'a pas oublié l'étang limousin de l'enfance et vit entouré d'animaux, d'aquariums et de plantes, comme autant de compagnons nécessaires pour traverser la ville.
Pierre Gondran dit Remoux est né en 1970 à Limoges. Ingénieur agronome de formation, ce Parisien d'adoption n'a pas oublié l'étang limousin de l'enfance et vit entouré d'animaux, d'aquariums et de plantes, comme autant de compagnons nécessaires pour traverser la ville.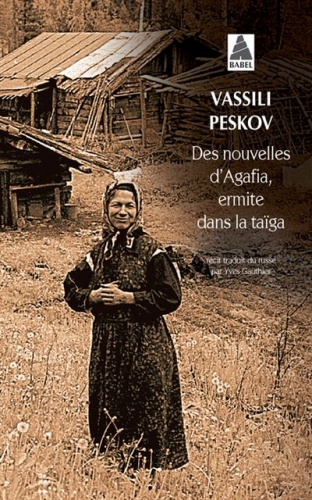
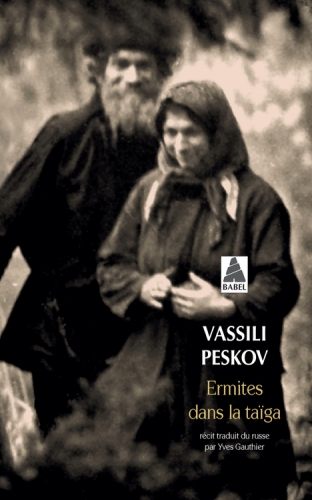




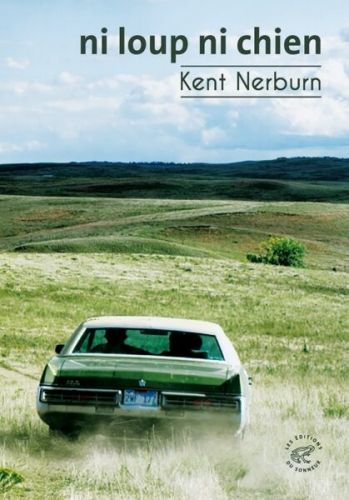
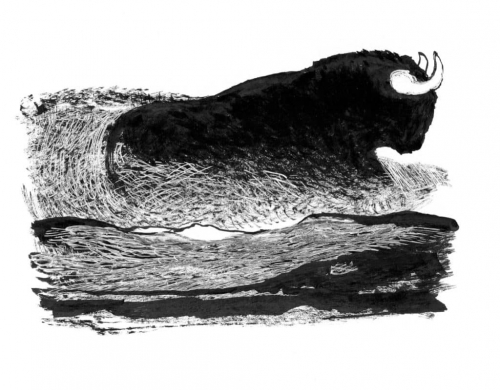
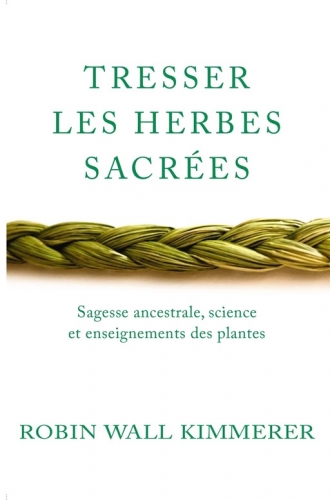
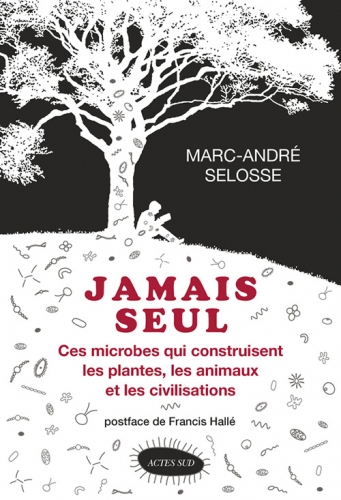 Enfin retrouvé suffisamment de concentration pour terminer ce livre méga intéressant de Marc-André Selosse, vraiment j'ai énormément appris et même si c'est un peu ardu par moment, c'est un livre incontournable pour appréhender le vivant, en réformer nos visions hygiénistes et nos manies du contrôle totalement obsolètes et même ridicules, bref à lire vraiment !!
Enfin retrouvé suffisamment de concentration pour terminer ce livre méga intéressant de Marc-André Selosse, vraiment j'ai énormément appris et même si c'est un peu ardu par moment, c'est un livre incontournable pour appréhender le vivant, en réformer nos visions hygiénistes et nos manies du contrôle totalement obsolètes et même ridicules, bref à lire vraiment !!