Je te vois de Murièle Modély
Ed. du Cygne, septembre 2014

112 pages - 13€
Le couple, « nous sommes ensemble et seul », colonne vertébrale de ce recueil, qui vient prendre et surprendre le lecteur, comme sait si bien le faire Murièle Modély avec cette langue et ce style bien à elle.
Dans Je te vois, il est question du corps, des mots, des maux du corps et du corps des mots dans l’aquarium du couple. Et donc de sexe forcément, presque un acte de survie, pour faire taire un temps les angoisses, pour que la tête se taise et que l’animal en nous « nos dents crissent nos mains aboient » fasse obstacle et contrepoids, le temps d’une rupture de conscience, à la banale horreur du monde, « ce rat crevé qui soubresaute ».
« je ne suis pas la première/à vouloir que le noir/m’arrache les cheveux/et le cuir/et le crâne/et les lobes/et les yeux/à vouloir que la baise/me fasse sentir mieux. »
« les jambes s’ouvrent, les yeux se ferment ». Le sexe dont Muriel Modély trace à grands jets les contours, où le creux appelle le plein parce que l’extérieur semble trop vide, le sexe comme une salutaire amnésie plus ou moins quotidienne, parce que « pendant que dans nos ventres se jouent sans anicroche/le va/ le vient/l’histoire la même/dans la répétition des coups de reins », on tient à distance la peur, la faim et la mort, et surtout, paradoxalement, « on tue la vie » comme si « la mort petite » faisait moins mal. « je veux juste ton sexe sous mes voiles de chair ».
Le couple, une protection : « je porte ta peau en rempart », contre un monde extérieur vécu comme aussi monotone qu’hostile. L’hiver est continu le présent nous bombarde/ses rayons dardent puis nous charrient/dans les allées des centres commerciaux. Un monde à mastiquer, où l’on consomme et se fait consommer. « Je nous vois aussi attablés et assis/lécher la poussière des fonds de verre ».
Ce recueil semble bâti sur des oppositions, des équilibres à trouver, comment passer sans dégât de la contraction à la dilatation, de la protection à l’ouverture. Toi/moi, homme/femme, vie/mort, sexe/mort, sexe/vie, dehors/dedans, désir/dégoût. Les mots mentent, les corps ne mentent pas, ou bien est-ce l’inverse ? Et l’auteur « déboule dévêtue dans les champs sémantiques ».
Avidité, turgescence, le jouir et le vomir. Le couple et la faille. Les corps s’unissent, les mots disent la dichotomie : « Je fais l’amour, tu baises. » Mais « qui en définitive pénètre l’autre ? ».
« la langue suce dissout/le réel ». Sexe et écriture tamisent le réel dont la violence peut devenir insupportable. On sent quelque chose qui se braque au fond du ventre. Peur ancestrale peut-être, « rien à voir avec ces trucs de fille/le genre qui revient tous les vingt-huit du mois ».
Dans ce recueil, parfois les mots ne disent pas, tournent, évoquent, mais comme le sexe, une part de l’écriture permet sans doute à l’auteur de s’échapper par le trou des mots, mais en même temps, encore le paradoxe : « le mot n’est-il pas un pilon plus puissant/que n’importe laquelle de nos excroissances » ?
Sexe/mots qui déchirent, sexe/mots qui recousent et Murièle Modély de confier sa « fascination malsaine/ pour les cicatrices ».
Il y a dans ce recueil plus que les précédents peut-être, quelque chose de non-accouché et les mots tournent autour du point source de la douleur et même parfois semblent distraire l’attention du lecteur pour qu’il regarde ailleurs. Douleur trop vive ?
Le livre s’achève cependant dans une sorte d’apaisement, l’amour comme une couverture qui vient recouvrir et réchauffer les corps, mais y croit-on vraiment ?
Cathy Garcia
 Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, à l’île de la Réunion et vit maintenant à Toulouse. Bibliothécaire de profession, elle commence à explorer l’écriture poétique sur son blog (www.l-oeil-bande.blogspot.fr.) avant de participer à des revues telles que Nouveaux Délits, Les tas de mots, Poème sale, Microbe, ou encore Traction Brabant.
Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, à l’île de la Réunion et vit maintenant à Toulouse. Bibliothécaire de profession, elle commence à explorer l’écriture poétique sur son blog (www.l-oeil-bande.blogspot.fr.) avant de participer à des revues telles que Nouveaux Délits, Les tas de mots, Poème sale, Microbe, ou encore Traction Brabant.
Bibliographie :
- Penser Maillée, Éditions du Cygne, 2012 - Rester debout au milieu du trottoir, Éditions Contre-Ciel, 2014
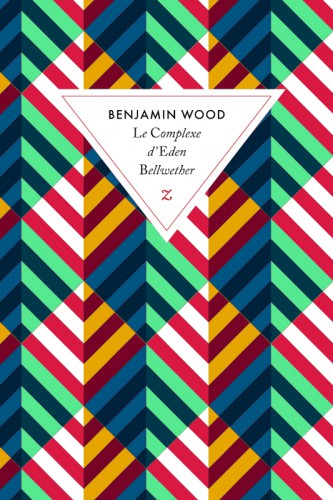
 Benjamin Wood, né en 1981, a grandi dans le nord-ouest de l’Angleterre. Amplement salué par la critique et finaliste de nombreux prix, le Complexe d’Eden Bellwether est son premier roman.
Benjamin Wood, né en 1981, a grandi dans le nord-ouest de l’Angleterre. Amplement salué par la critique et finaliste de nombreux prix, le Complexe d’Eden Bellwether est son premier roman. 
 Eun Hee-kyung est née en 1959 dans la région de Gochang, Jeollabuk-do. Elle fait ses débuts littéraires en 1995 avec le court roman Duet et reçoit le premier Prix Munhakdongne du Roman la même année pour Le Cadeau De l’Oiseau, qui séduit tant les critiques que les lecteurs. Elle fait aujourd’hui partie des auteures les plus célèbres de Corée. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix de Littérature Dongseo en 1997, le Prix de Littérature Yi Sang en 1998 et le Prix Coréen de Littérature en 2000. Ses œuvres les plus représentatives incluent les recueils de nouvelles To Talk With Strangers (1996), Happy Ones Do Not Look At The Clock (1999), Inheritance (2002) et Beauty Despises Me (2007), ainsi que les romans Le Cadeau De L’Oiseau (1995), Save The Last Dance For Me (1998), Minor League (2001) et Secrets And Lie (2005).
Eun Hee-kyung est née en 1959 dans la région de Gochang, Jeollabuk-do. Elle fait ses débuts littéraires en 1995 avec le court roman Duet et reçoit le premier Prix Munhakdongne du Roman la même année pour Le Cadeau De l’Oiseau, qui séduit tant les critiques que les lecteurs. Elle fait aujourd’hui partie des auteures les plus célèbres de Corée. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix de Littérature Dongseo en 1997, le Prix de Littérature Yi Sang en 1998 et le Prix Coréen de Littérature en 2000. Ses œuvres les plus représentatives incluent les recueils de nouvelles To Talk With Strangers (1996), Happy Ones Do Not Look At The Clock (1999), Inheritance (2002) et Beauty Despises Me (2007), ainsi que les romans Le Cadeau De L’Oiseau (1995), Save The Last Dance For Me (1998), Minor League (2001) et Secrets And Lie (2005).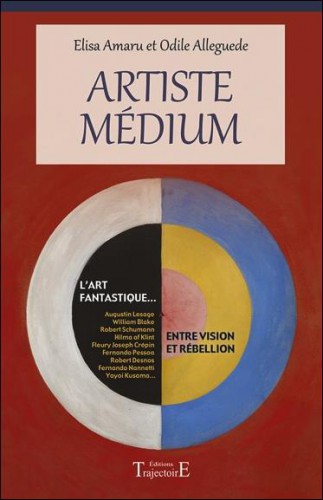
 Élisa Amaru
Élisa Amaru Odile Alleguede
Odile Alleguede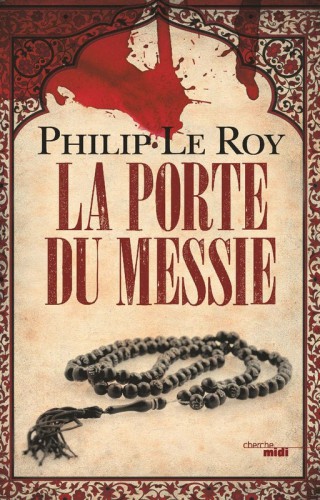
 Philip Le Roy est un auteur français de polars, né en 1962 à Toulouse. Autodidacte doublé d'un globe trotteur. Touche-à-tout, il est à la fois adepte des arts martiaux (viet vo dao), bassiste rock à ses heures, ancien publicitaire et auteur de romans (très) noirs depuis 1997.Après Pour adultes seulement, lauréat du Prix du polar de Toulouse et Couverture dangereuse, deux premiers romans noirs, il est révélé en 2005 par le Grand Prix de littérature policière pour Le Dernier Testament, où apparaît pour la première fois Nathan Love. En 2007 paraît La Dernière Arme, deuxième enquête du profiler zen. Ses livres sont publiés dans la collection Points Thriller et sont traduits en Italie, Espagne, Russie, Allemagne, Corée…
Philip Le Roy est un auteur français de polars, né en 1962 à Toulouse. Autodidacte doublé d'un globe trotteur. Touche-à-tout, il est à la fois adepte des arts martiaux (viet vo dao), bassiste rock à ses heures, ancien publicitaire et auteur de romans (très) noirs depuis 1997.Après Pour adultes seulement, lauréat du Prix du polar de Toulouse et Couverture dangereuse, deux premiers romans noirs, il est révélé en 2005 par le Grand Prix de littérature policière pour Le Dernier Testament, où apparaît pour la première fois Nathan Love. En 2007 paraît La Dernière Arme, deuxième enquête du profiler zen. Ses livres sont publiés dans la collection Points Thriller et sont traduits en Italie, Espagne, Russie, Allemagne, Corée…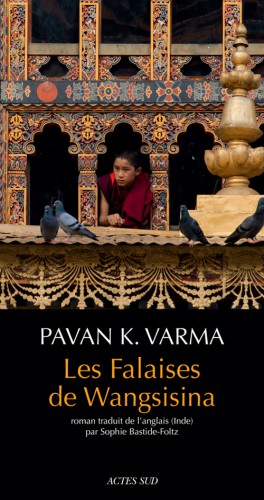
 Diplomate, essayiste, traducteur, Pavan K. Varma est aujourd’hui ambassadeur de l’Inde au Bhoutan. Actes Sud a déjà publié Le Défi indien (2005, Babel n° 798), La Classe moyenne en Inde (2009) et Devenir Indien (2011). Les Falaises de Wangsisina est sa première incursion dans la fiction.
Diplomate, essayiste, traducteur, Pavan K. Varma est aujourd’hui ambassadeur de l’Inde au Bhoutan. Actes Sud a déjà publié Le Défi indien (2005, Babel n° 798), La Classe moyenne en Inde (2009) et Devenir Indien (2011). Les Falaises de Wangsisina est sa première incursion dans la fiction.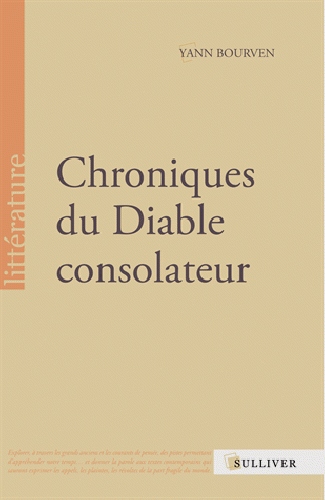

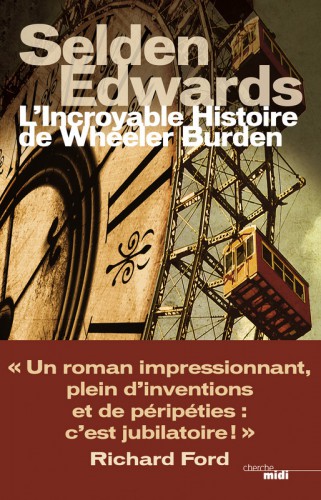
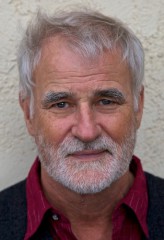 Né en 1945, Selden Edwards est professeur. Il vit en Californie, à Santa Barbara. L’Incroyable Histoire de Wheeler Burden est son premier roman. Il y a travaillé pendant près de trente ans.
Né en 1945, Selden Edwards est professeur. Il vit en Californie, à Santa Barbara. L’Incroyable Histoire de Wheeler Burden est son premier roman. Il y a travaillé pendant près de trente ans.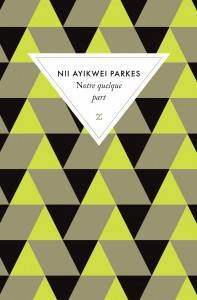
 Romancier, poète du spoken word, nourri de jazz et de blues, Nii Ayikwei Parkes est né au Ghana en 1974. Il partage sa vie entre Londres et Accra. Notre quelque part, est son premier roman, très remarqué, finaliste du Commonwealth Prize.
Romancier, poète du spoken word, nourri de jazz et de blues, Nii Ayikwei Parkes est né au Ghana en 1974. Il partage sa vie entre Londres et Accra. Notre quelque part, est son premier roman, très remarqué, finaliste du Commonwealth Prize.

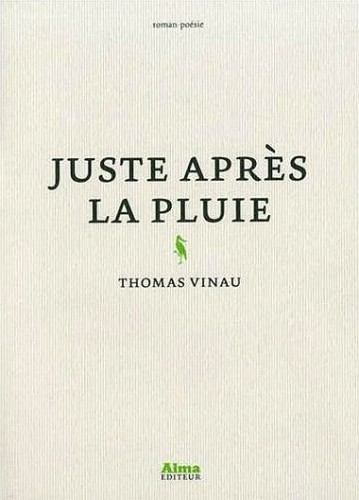
 Thomas Vinau est né en 1978 à Toulouse.
Thomas Vinau est né en 1978 à Toulouse.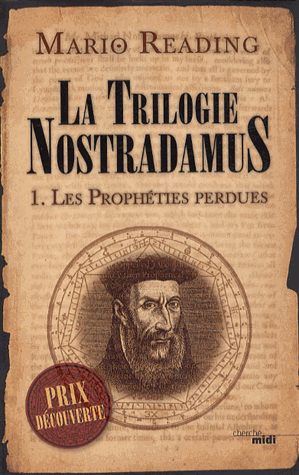


 Né à Port-au-Prince, Gary Victor est plébiscité par les lecteurs en Haïti. Après des études d’agronomie, il exerce le métier de journaliste durant de nombreuses années et a occupé des postes importants dans la fonction publique haïtienne. Fils de René Victor, qui est peut-être le sociologue le plus important de son pays, l’écrivain en a hérité un regard lucide sur sa société. Ses créations explorent sans complaisance aucune le mal-être haïtien pour tenter de trouver le moyen de sortir du cycle de la misère et de la violence. Son roman, À l’angle des rues parallèles, a obtenu le prix de fiction du livre insulaire à Ouessant 2003. Il a fait également l’objet d’une adaptation au théâtre. Outre son travail d’écriture, Gary Victor est scénariste pour la radio, le cinéma et la télévision. Esprit rebelle, indépendant, ses réflexions sur la société haïtienne ont quotidiennement fait des vagues sur les ondes de l'une des stations de radio de Port-au-Prince, et son feuilleton télévisé sur les mœurs de la petite bourgeoisie haïtienne a été adapté au cinéma.
Né à Port-au-Prince, Gary Victor est plébiscité par les lecteurs en Haïti. Après des études d’agronomie, il exerce le métier de journaliste durant de nombreuses années et a occupé des postes importants dans la fonction publique haïtienne. Fils de René Victor, qui est peut-être le sociologue le plus important de son pays, l’écrivain en a hérité un regard lucide sur sa société. Ses créations explorent sans complaisance aucune le mal-être haïtien pour tenter de trouver le moyen de sortir du cycle de la misère et de la violence. Son roman, À l’angle des rues parallèles, a obtenu le prix de fiction du livre insulaire à Ouessant 2003. Il a fait également l’objet d’une adaptation au théâtre. Outre son travail d’écriture, Gary Victor est scénariste pour la radio, le cinéma et la télévision. Esprit rebelle, indépendant, ses réflexions sur la société haïtienne ont quotidiennement fait des vagues sur les ondes de l'une des stations de radio de Port-au-Prince, et son feuilleton télévisé sur les mœurs de la petite bourgeoisie haïtienne a été adapté au cinéma.
 Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, à l’île de la Réunion et vit maintenant à Toulouse. Bibliothécaire de profession, elle commence à explorer l’écriture poétique sur son blog (www.l-oeil-bande.blogspot.fr.) avant de participer à des revues telles que Nouveaux Délits, Les tas de mots, Poème sale, Microbe, ou encore Traction Brabant.
Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, à l’île de la Réunion et vit maintenant à Toulouse. Bibliothécaire de profession, elle commence à explorer l’écriture poétique sur son blog (www.l-oeil-bande.blogspot.fr.) avant de participer à des revues telles que Nouveaux Délits, Les tas de mots, Poème sale, Microbe, ou encore Traction Brabant.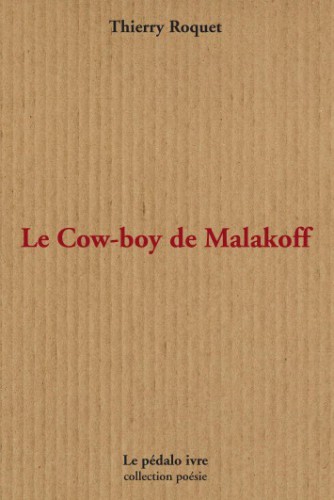
 Né en 1968 en Bretagne, Thierry Roquet vit à Malakoff (banlieue sud de Paris). Après une adolescence boutonneuse et solitaire, des études assez vite écourtées, divers boulots alimentaires, des lectures marquantes, une belle histoire d’amour, un enfant et un licenciement (presque) à l’amiable, s’oriente vers l’écriture (du quotidien) petit format… mais longue durée. Ne compte pas s’arrêter là. Inch’allah !
Né en 1968 en Bretagne, Thierry Roquet vit à Malakoff (banlieue sud de Paris). Après une adolescence boutonneuse et solitaire, des études assez vite écourtées, divers boulots alimentaires, des lectures marquantes, une belle histoire d’amour, un enfant et un licenciement (presque) à l’amiable, s’oriente vers l’écriture (du quotidien) petit format… mais longue durée. Ne compte pas s’arrêter là. Inch’allah !