Yann Bourven
Je ne débande plus, regarde-là, elle est dure comme du bois ! Tâte ces veines diurnes qui surgissent une à une gonflées à mort ! De vraies racines qui palpitent !
in Chroniques du Diable consolateur
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Je ne débande plus, regarde-là, elle est dure comme du bois ! Tâte ces veines diurnes qui surgissent une à une gonflées à mort ! De vraies racines qui palpitent !
in Chroniques du Diable consolateur



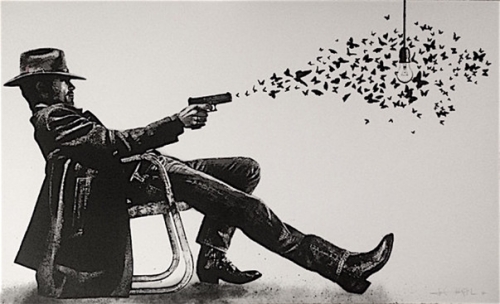
Rire est une manière simple de se venger
C’est ce que je disais dans une lettre adressée à demain
Mais il n’a toujours pas compris
Son QI ressemble à une affiche électorale

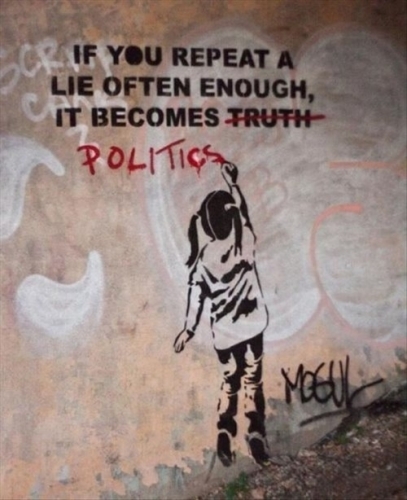
pas mal réussie cette adaptation du célèbre roman de Bradbury...

Une nouvelle invasion :
L’écho du tonnerre retentit, les enfants jouent le rite tape-pierre de l’orage.
La fin et le début du temps s’enroulent
et se déroulent simultanément sur l’axe des pôles.
Un sifflement sourd tout le jour t’enfonce sous la terre des ancêtres.
in Zoartoïste
