Simon Kirk - Dreams - Collage and Mixed Media 2015

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Seuil, collection Fiction et Cie, 8 janvier 2015
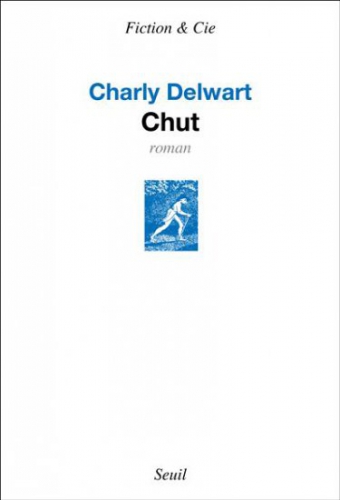
176 pages - 17.00 €.
« L’univers est un test d’intelligence » Timothy Leary
Ce livre semble parfois un peu difficile à lire, le style de l’auteur est particulier, comme heurté, des tournures, des cassures, qui déstabilisent, mais en nous glissant dans la peau d’une jeune athénienne de 14 ans, Charly Delwart nous fait revivre les évènements qui ont fait culbuter la Grèce. La Grèce exsangue de la Troïka, otage du FMI, de la BCE et de comptes falsifiés avec la complicité de la Goldman Sachs…. Une Grèce qui ne peut oublier Alexandros Grigoropoulos « abattu par un policier lors d’une manifestation liée à la situation économique du pays », en 2008, il avait 15 ans. Une Grèce, grand laboratoire à ciel ouvert aux quatre veines, de politiques toujours plus d’austérité, une Grèce où les vieillards se suicident pour ne pas peser sur leurs enfants, le premier fut Dimitris Christoulas, pharmacien à la retraite de 77 ans, qui se met une balle dans la tête sur la place Syntagma. Une Grèce où des mères ne reviennent pas chercher leurs enfants à la crèche, sachant qu’au moins là-bas ils seront nourris, la Grèce qui bascule dans un gouffre sous la loupe de l’Europe…
La jeune fille qui s’exprime ici sous la plume de l’auteur, fait face à bien des bouleversements, à la fois à l’extérieur du foyer mais aussi à l’intérieur, un frère parti à l’étranger, les parents qui se séparent et même à l’intérieur d’elle-même à un âge sensible où l’enfance cède place à la femme en devenir. Aussi pour encaisser tous ces chocs, cet afflux de tensions et de nouvelles données, elle décide de ne plus parler. « Il y a une théorie qui disait que toute parole qu’on ne dit pas est une particule d’énergie qu’on garde pour soi, que cela rend plus fort, et c’est cela dont j’avais besoin, d’énergie, d’être plus concentrée, plus avec moi-même ». Ne plus parler donc, mais écrire, beaucoup et communiquer uniquement par écrit par le biais d’un cahier.
Cette prise de distance va lui permettre de réfléchir, d’observer, car elle sait qu’elle fait partie de ceux qui devront reconstruire la Grèce, de ceux qui doivent voir au-delà du présent, au-delà des ruines et du foutu. Elle cherche à comprendre, cherche le parallèle entre tous les mouvements de contestation qui s’amplifient un peu partout dans le monde, avec la Californie du début des années 70, elle espère que du chaos une nouvelle et meilleure façon de vivre va émerger. Autour d’elle, les murs d’Athènes se sont eux aussi couverts d’écriture, comme s’ils crachaient des mots, des phrases, « des tags, des aplats de peinture rouge pour symboliser le sang des Grecs qui payaient le prix de l’austérité, tout ce qui véhiculait le ras-le-bol, une angoisse, une colère », des slogans qui dénoncent, qui haranguent, qui interpellent : FMI DEHORS, CECI EST UNE DÉMOCRATIE DE MERDE, RÉVOLTE, PAS DÉSESPOIR, ATHÈNES BRÛLE, JE ME FOUS DE VOTRE ARGENT, VIVEZ VOTRE GRÈCE EN MYTHE, AUCUN HOMME N’EST CLANDESTIN. Aussi, l’adolescente va elle aussi commencer à écrire sur les murs, clandestinement, des phrases qui lui viennent de ses observations et réflexion, des phrases inspirées mais différentes, des phrases de poètes et de philosophes qui ouvrent d’autres horizons, d’autres possibles, des phrases à elle, des phrases qui sont elle… « Prenant le tube de rouge à lèvres laissé par ma sœur pour écrire au-dessus mon nom : DIMITRA AEGIOLIS. La seule inscription à mettre ».
C’est donc à une plongée dans la Grèce en ébullition, que nous convie l’auteur, et à la naissance d’une jeune femme, et c’est là tout l’intérêt de cette fiction, avec ce séjour chez la grand-mère de la narratrice, sur l’île de Sérifos, là où la Grèce est encore à l’image de l’aïeule. Une vieille femme enracinée, forte et digne, qui a connu la guerre et la dictature des Colonels, dans cette Grèce millénaire qui a traversé tant d’épreuves déjà et s’est toujours relevée. Une image « de courage et d’espoir ». Voilà ce qu’on retiendra de Chut. Une chute ou le e se fait muet, pour prendre le temps de se relever. « Or c’est parce que tout était trop réel que quelque chose semblait changer, que des initiatives apparaissaient ; les habitants comprenant qu’ils étaient interdépendants, face à l’impuissance du gouvernement, son abandon. »
VOUS ÊTES FORTS DE CE QUE VOUS SAVEZ MAINTENANT.
Une Grèce qui est donc aussi le laboratoire à ciel ouvert et sans y perdre de sang cette fois, un laboratoire des libertés, des nouvelles alternatives, de la solidarité « Un système d’aller-retour direct entre les gens qui n’était pas une alternative à l’euro mais à la vie elle-même (…), pour montrer que tous valaient ce qu’ils avaient à donner et non ce qu’ils avaient en banque. »
Un hommage à tous ceux qui, dans le monde, ont écrit ou écrivent sur les murs pour la liberté et la dignité et à tous ceux qui œuvrent pour que le monde devienne meilleur.
Cathy Garcia
 Charly Delwart est né à Bruxelles en 1975. Il vit entre la Belgique et la France où il travaille dans le cinéma. Il a écrit trois livres : Circuit (Seuil, 2007 et Labor« Espace Nord » 2014), L'Homme de profil même de face (Seuil, 2010) et Citoyen Park (Seuil, 2012).
Charly Delwart est né à Bruxelles en 1975. Il vit entre la Belgique et la France où il travaille dans le cinéma. Il a écrit trois livres : Circuit (Seuil, 2007 et Labor« Espace Nord » 2014), L'Homme de profil même de face (Seuil, 2010) et Citoyen Park (Seuil, 2012).
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/chut-charly-delwart

La télévision est une plaie, une plaie d'autant plus vive que nul ne songe à la fermer. Alors, elle reste ouverte à longueur de journée et ce pâle reflet, qui ne veut pas guérir, devient un mal atroce dont on se met à jouir.
in Quinze lieux communs
dans la boîte à clous
tous les clous
sont tordus

Passez entre les fleurs et regardez :
Au bout du pré c’est le charnier.
Pas plus de cent, mais bien en tas,
Ventre d’insecte un peu géant
Avec des pieds à travers tout.
Le sexe est dit par les souliers,
Les regards ont coulé sans doute.
— Eux aussi
Préféraient des fleurs.
*
À l’un des bords du charnier,
Légèrement en l’air et hardie,
Une jambe — de femme
Bien sûr —
Une jambe jeune
Avec un bas noir
Et une cuisse,
Une vraie,
Jeune — et rien,
Rien.
*
Le linge n’est pas
Ce qui pourrit le plus vite.
On en voit par là,
Durci de matières.
Il donne apparence
De chairs à cacher qui tiendraient encore.
*
Combien ont su pourquoi,
Combien sont morts sachant,
Combien n’ont pas su quoi ?
Ceux qui auront pleuré,
Leurs yeux sont tout pareils,
C’est des trous dans des os
Ou c’est du plomb qui fond.
*
Ils ont dit oui
À la pourriture.
Ils ont accepté,
Ils nous ont quittés.
Nous n’avons rien à voir
Avec leur pourriture.
*
On va, autant qu’on peut,
Les séparer,
Mettre chacun d’eux
Dans un trou à lui,
Parce qu’ensemble
Ils font trop de silence contre le bruit.
*
Si ce n’était pas impossible,
Absolument,
On dirait une femme
Comblée par l’amour
Et qui va dormir.
*
Quand la bouche est ouverte
Ou bien ce qui en reste,
C’est qu’ils ont dû chanter,
Qu’ils ont crié victoire,
Ou c’est le maxillaire
Qui leur tombait de peur.
— Peut-être par hasard
Et la terre est entrée.
*
Il y a des endroits où l’on ne sait plus
Si c’est la terre glaise ou si c’est la chair.
Et l’on est peureux que la terre, partout,
Soit pareille et colle.
*
Encore s’ils devenaient aussitôt
Des squelettes,
Aussi nets et durs
Que de vrais squelettes
Et pas cette masse
Avec la boue.
*
Lequel de nous voudrait
Se coucher parmi eux
Une heure, une heure ou deux,
Simplement pour l’hommage.
*
Où est la plaie
Qui fait réponse ?
Où est la plaie
Des corps vivants ?
Où est la plaie.
Pour qu’on la voie,
Qu’on la guérisse.
*
Ici
Ne repose pas,
Ici ou là, jamais
Ne reposera
Ce qui reste,
Ce qui restera
De ces corps-là.

Un poète, c'est joli quand un siècle a passé, que c'est mort dans la terre et vivant dans les textes. Mais quand c'est chez vous, un enfant épris d'absolu, bouclé dans sa chambre avec ses livres, comme un jeune fauve dans sa tanière enfumée par Dieu, comment l'élever ? Les enfants savent tout du ciel jusqu'au jour où ils commencent à apprendre des choses. Les poètes sont des enfants ininterrompus, des regardeurs de ciel, impossible à élever.
in La dame blanche



Pour nous qui vivons de plus en plus entourés de masques et de schémas intellectuels, et qui étouffons dans la prison qu’ils élèvent autour de nous, le regard du poète est le bélier qui renverse ces murs et nous rend, ne serait-ce qu’un instant, le réel ; et avec le réel, une chance de vie.
in L’entretien des Muses


