Andy Leader - Ford Inn sheep - Yorkshire - Angleterre

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.








Fournaise dans les veines
du grand dragon
qui se réveille
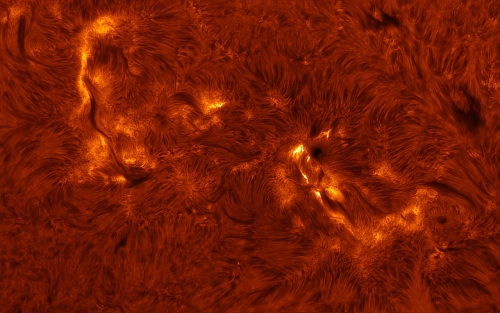

Elle arrive de loin
envoyée des profondeurs
catasismiques
des genèses prolifiques
elle arrive
écume légère
langue de lumière
pour lécher les ténèbres
elle arrive la toute douce
inspire
ouvre tes poumons
à la puissance
de son déferlement
sens battre dans tes reins
le vieux tambour
de toutes les origines


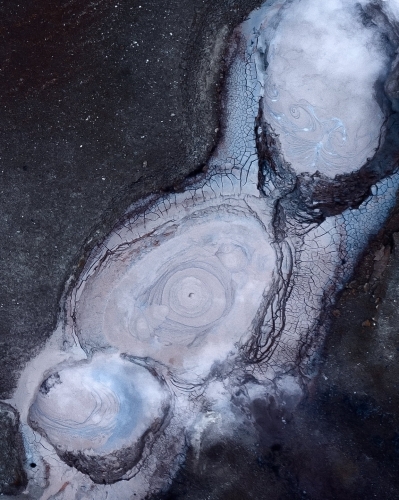
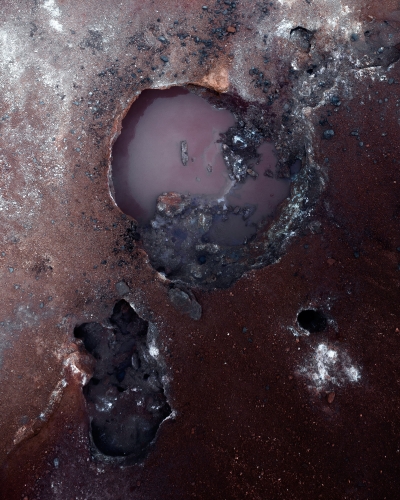



matin de décembre
passements de lumière
dans la trame des arbres nus
or du solstice
bientôt avenu