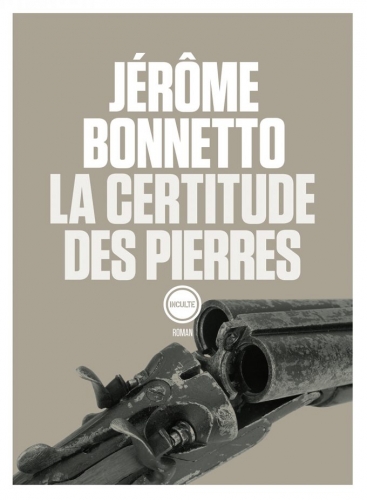traduit de l’Espagnol (Salvador) par René Solis
Métailié, février 2020
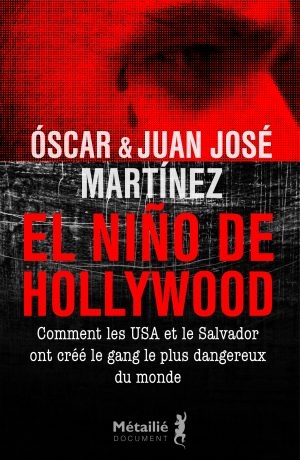
332 pages, 22 €
« Je voudrais pouvoir revenir en arrière, et pas aller avec la Mara…
Aux mioches, moi je leur dis, ne le faites pas, disait El Niño. »
Miguel Ángel Tobar, celui qui fut d’abord El Payaso, Le Clown, puis El Niño de Hollywood, du nom de la branche de la Mara Salvatrucha 13 à laquelle il appartenait, les Hollywood Locos, dont il fut l’un des plus redoutables sicario, avant de devenir un misérable témoin protégé de l’État salvadorien, après avoir dénoncé un bon nombre de mareros, dont son pandillero, son chef, Chepe Furia. Chepe Furia, de son vrai nom José Antonio Terán, avait été dans les années 70, un policier de l’ultra brutale police d’État, la Garde Nationale de sinistre mémoire où il était alors connu sous le nom d’El Veneno, le Poison, ce n’est que bien plus tard qu’il reviendra au Salvador, sous le nom de Chepe Furia, membre de la Mara Salvatrucha 13.
José Antonio Terán avait fui le pays, sa guerre intestine et ses propres exactions. Dans les années 70, il y avait eu une fuite en masse des Salvadoriens vers le sud de la Californie, puis ces derniers — dont bon nombre avaient rejoint les gangs — furent expulsés sous le gouvernement de Reagan. Des centaines de membres de la Mara Salvatrucha 13 (la MS-13), qui en 1992 était le gang le plus puissant de Californie et du Barrio 18 qui lui s’était rallié au système des gangs sureños, principalement d’origine mexicaine, comme l’indique le chiffre 18, contrairement à la MS-13. Les deux gangs étaient ennemis et se disputaient des territoires. Les Salvadoriens n’ayant connu que l’ultra-violence dans leur propre pays, dressés tout jeunes à tuer, n’avaient respecté aucune règle des autres gangs des ghettos californiens à leur arrivée. Sales, adeptes des drogues et de l’alcool, tous vêtus de noir avec les cheveux longs, jeunes fans absolus et très perturbés de heavy metal aux pratiques macabres, la MS-13 s’était vite fait une réputation avant de s’organiser en gang plus conforme niveau look à l’image des autres gangs californiens, mais avec toujours une longueur d’avance sur leur capacité de violence pure.
Une fois de retour au Salvador, les deux gangs ennemis se sont donc reformés. La MS-13, avec ses différentes branches, a alors conforté et prouvé sa réputation de gang du XXIe siècle le plus violent au monde, aussi bien vis-à-vis de l’extérieur qu’à l’intérieur même de celui-ci. C’est le seul a être sur la liste noire du département du Trésor des États-Unis, ses membres qualifiés d’animaux par Trump, « ce président ignorant (….) et non d’animaux humains créés par d’autres humains ».
El Niño de Hollywood n’a jamais mis les pieds aux États-Unis, encore moins à Hollywood, mais il fait partie de ses enfants perdus, issus de familles totalement éclatées, dans un pays ravagé par des décennies de guerre et qui n’ont déjà connu que la violence et la misère.
Ainsi, en un peu plus de trois cents pages, parfois très dures, le lecteur pourra comprendre ce qui a bien pu faire de ce tout petit pays d’Amérique centrale, le pays le plus meurtrier du monde avec un taux d’homicides absolument dément. Il faut pour cela remonter au XIXe siècle, à l’époque où des propriétaires terriens faisaient fortune avec l’indigo et avaient pour cela relégué les populations indiennes sur les terres non exploitables à flanc de montagnes. Quand la découverte inopinée, à Londres, du premier colorant de synthèse, bleu donc, fait chuter brutalement la demande et le cours de l’indigo, l’élite des propriétaires terriens à l’initiative du président alors en place, Gerardo Barrios, va se reconvertir très vite dans le café et pour cela elle a besoin des terres en pente qu’elle avait laissées aux Indiens, mais aussi de leurs mains pour récolter. Le traitement qui est infligé alors à cette main d’œuvre, déjà humiliée par le régime colonial espagnol, est tel que cette population dont la colère et la frustration a atteint un point de non retour, n’ayant rien de plus à perdre, commence à se rebeller au début des années 30, ce qui entraînera aussitôt une répression féroce, la Matanza : en 1932, « au moins quinze mille personnes, des hommes jeunes dans leur majorité, ont été assassinées dans la région occidentale du Salvador en quelques mois (…) et une bien plus grande quantité encore a été exécutée durant le reste de l’année. Aucun de ces morts n’a été enregistré dans les registres d’homicides. »
Roque Dalton, poète salvadorien membre de l’organisation insurgée Armée révolutionnaire du peuple dans les années 1970, qui sera assassiné sur ordre des dirigeants de cette même organisation pour insoumission, écrivit à ce sujet :
« Nous sommes tous nés à demi morts en 1932
Nous survivons à demi vivants
Et chacun de nous porte une dette de trente mille morts bien entiers
Dont les intérêts ne cessent de gonfler
Et qui aujourd’hui suffit pour enduire de mort ceux qui continuent
À naître
À demi morts
À demi vivants
Nous sommes tous nés à demi morts en 1932
Être Salvadorien c’est être à demi mort
Ce qui bout
C’est la moitié de la vie qu’on nous a laissée… »
Mais comme souvent l’injustice et l’atrocité furent rentables : « Les riches sont devenus très riches dans les décennies qui ont suivi 1932. Les pauvres, eux, ne pouvaient être plus pauvres. »
Mais ces pauvres soutenus par les idéaux marxistes s’organisent dans les années 70, le pays entre alors dans l’une des dictatures les plus sadiques d’Amérique centrale, composée de militaires putschistes d’extrême-droite avec comme d’habitude la participation de la CIA, le but étant comme toujours de protéger les possessions et privilèges de la classe dominante. La guérilla est forte et brutale elle aussi, nourrie de plus d’un siècle d’injustices sans réparation. Dans un pays composé alors « à plus de 60 % par des enfants, le résultat était prévisible. Des milliers de mineurs de moins de 15 ans ont été recrutés des deux côtés. (…) Le Salvador, un pays vingt fois plus petit que la Californie, s’est lancé avec ses armées adolescentes dans l’abîme dont il devait ressortir en 1992 avec pour bilan plus de soixante-quinze mille morts et une immense quantité de personnes déplacées.»
Voilà le terreau de tant de morts déjà décomposés, dans lequel les gangs made in USA viendront semer leurs graines assassines.
Qui dit guerre, dit ennemi, la nécessité d’avoir un ennemi à combattre, « l’envie irrépressible de détester quelqu’un sans motif idéologique a été fondamentale dans la construction du Salvador ». La minorité possédante demeurant, quoiqu’il arrive, intouchable, on entre donc dans la logique des clans, où la raison de vivre est la mort de l’autre. Quand les membres des gangs comme Chepe Furia et bien d’autres, dont certains étaient partis trop jeunes pour connaître leur pays, sont expulsés de Californie vers la fin des années 90, une certaine aura les entoure aux yeux de la jeunesse qui a grandi dans la misère au Salvador dans un environnement très rural.
« Les États-Unis vomissaient.
Sans comprendre ce qu’ils faisaient.
La migration est un cercle.
Des recruteurs pour tout le Salvador.
Des recruteurs d’enfants perdus pour tout le Salvador.
Des chefs de clans pour tout le Salvador.
Un pays en reconstruction.
Un pays en ruines.
Un pays qui n’avait pas le temps pour les enfants perdus.
La guerre expulsée des rues de Californie aux rues du Salvador.
Une guerre s’achevait. Une autre commençait. »
Il fut très facile pour Chepe Furia, auréolé de son parcours de « combattant » et fort de son expérience d’ex-policier de la Garde Nationale, de manipuler ces « enfants de personne », les enfants de la guerre. « Enfants de familles dysfonctionnelles fabriquées avec des restes d’autres familles », leur seule consigne : survivre. « Beaucoup d’entre eux faisaient face aux déceptions de la vie de la même façon que leurs pères, à grandes rasades d’alcool de canne, le guaro. ». Illettrés, misérables, déjà confrontés à la violence, ils étaient d’autant plus manipulables qu’ils étaient mus par un désir de valorisation, de reconnaissance et notamment de la part d’un père souvent inexistant ou minable comme celui d’El Niño, alcoolique lui-même victime de son propre tragique destin, qui vendait sa fille de 15 ans à son contremaître.
C’est le 24 décembre 1994 exactement, que Miguel Ángel Tobas, celui qui deviendra El Niño de Hollywood, né en 1981 dans une plantation de café, a pour la première fois, tenté de tuer un homme : le contremaître qui violait sa sœur. Une première tentative ratée à coups de gourdin et de pierres, « grosses comme les pierres qu’un enfant de 11 ans mal nourri peut soulever », l’enfant déçu de lui-même avait toutefois emporté un révolver .38, qu’il avait trouvé à la ceinture de cet homme.
Cette reconnaissance, les enfants de personne achetés par quelques bouteilles d’alcool par Chepe Furia, l’obtiendront ou croiront l’obtenir au prix du sang.
« Le secret, c’est que leur rêve n’est pas de devenir riche, mais d’être quelqu’un. Quelqu’un de différent de ce qu’ils étaient, (…) le rebut. »
Ils devront prouver leur allégeance totale à la Hollywood Locos Salvatrucha en assassinant violemment d’autres gamins absolument semblables à eux, dans une guerre contre cet ennemi déclaré, ceux de l’autre gang, avec bon nombre de victimes collatérales, mais aussi une guerre à l’intérieur même du gang contre les tièdes, les faibles et les traîtres, qui seront cruellement éliminés. Ainsi El Payaso, s’auto-nommera El Niño de Hollywood, — il a autour de 16 ans — par un meurtre particulièrement atroce car il ne s’agit pas seulement de tuer, mais aussi d’écrire avec le corps des victimes, celui-ci devenant un support pour transmettre un message qui doit faire horreur.
« Difficile d’arrêter une horde de chevaux emballés. Surtout si personne ne cherche à les arrêter. Surtout si quelqu’un les suit en les excitant. La haine qui s’est mise à rouler au Salvador a trouvé une interminable pente descendante. Elle roule toute seule. La première impulsion a suffi. La mort a donné du sens à toutes ces vies. »
Et à celle d’El Niño de Hollywood, devenu sicaire reconnu comme l’un des plus redoutables et le plus sanguinaire du gang des Hollywood Locos de la MS-13, dont il deviendra cependant lui aussi un traître et ne connaîtra plus jamais le repos, pas même après sa mort.
La boucle est bouclée, l’ultra-violence au Salvador est le mode de vie psychopathe de toute une partie de la jeunesse la plus pauvre. Les gangs, « une mafia, oui, mais toujours une mafia de pauvres. ».
« Tuer, haïr celui qui, sans te connaître, te tue, te hait », avec toute une mythologie, une mystique presque du meurtre, avec la Bête qui réclame sa part de sang. « Notre Bête à nous, elle est noire, c’est un cheval noir qui a le pouvoir, d’après l’Apocalypse, d’enlever la paix sur la terre. C’est une Bête de couleur noire avec une épée pointue. »
« Chepe Furia était intelligent pour créer des symboles, pour revêtir de transcendance ce qui n’était qu’un bain de sang contre des jeunes gens ».
On ne lit pas ce type de livre pour se divertir, à moins d’être soi-même un gros malade, non, on le lit pour comprendre comment cette violence est possible, comment des enfants de 10, 12 ans peuvent commettre des crimes aussi abominables, et devenir vers 16, 18 ans des tueurs déjà professionnels et à moitié, si ce n’est complètement, fous. On lit pour comprendre quel est le mécanisme à l’œuvre, pour comprendre comment tout cela a pu commencer et comme trop souvent, on trouvera à l’origine une élite possédante qui opprime, exploite et accule des populations à des situations d’injustice et de misère extrêmes et dans une spirale infernale, des décennies plus tard, toute une partie de la jeunesse d’un pays se retrouve pourrie jusqu’aux os, tellement qu’il n’est plus possible de distinguer les victimes des bourreaux.
Si les deux frères, auteurs de cet ouvrage magistral dans lequel la réalité pulvérise la fiction et qui ont réalisé là un travail de journalisme d’investigation courageux et réussi, s’intéressent de si près à El Niño de Hollywood qu’ils ont interviewé pendant des centaines d’heures, c’est bien parce que comme il le lui ont dit : « malheureusement, nous croyons que ton histoire est plus importante que ta vie… ».
On lit pour entrevoir l’humain derrière le monstre, pour nous rassurer nous-mêmes sans doute et il se trouve que l’humain est bien là, pris dans cette logique implacable qui le dépasse. Une multitude de fils de vies microscopiques qui se trouvent piégés ensemble dans la même trame, la toile souillée d’un sang qui n’en finit plus de couler.
« Au fil des mois et des années nous avons pu nous rendre compte que la vie de cet homme était conditionnée par des processus globaux, par des histoires à l’échelle mondiale dont il ignorait tout. Nous avons découvert que le pouvoir de décision, ce qu’on peut appeler la possibilité d’agir, a toujours était limité, toujours étroitement lié à des mécanismes lointains conçus par de hauts fonctionnaires aux États-Unis et au Salvador durant tout le XXe siècle. »
Personne ne voudrait être Miguel Ángel Tobar. « À présent il n’est plus que terre et racine. De l’engrais pour ce coin pourri du monde », laissant derrière lui, une très, trop jeune maman d’à peine 18 ans et leurs deux petites filles. Quelle histoire, quelle légende cette dernière leur racontera-t-elle à propos de leur père ?
Cathy Garcia
 Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
 Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
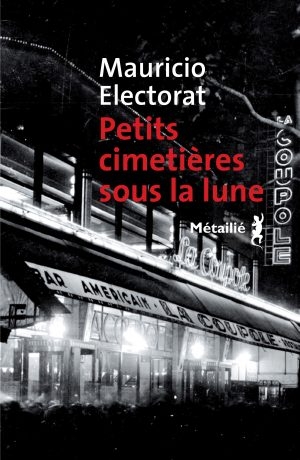
 Mauricio Electorat est né à Santiago du Chili en 1960. Après deux années d’études de journalisme et de littérature à Santiago, il s’installe à Barcelone en 1981, où il obtient une maîtrise en philologie hispanique. Petit fils de français émigrés à Valparaíso au début du XXe siècle, il choisit Paris comme lieu de résidence définitif dès 1987. Il a publié deux recueils de poésie. Son premier roman, Le Paradis trois fois par jour (Série noire, Gallimard, 1997), ainsi que son recueil de nouvelles Nunca fui a Tijuana y otros cuentos (Cuarto Propio, 2000) ont reçu le Prix de Littérature de la Ville de Santiago et le Prix du Conseil National du Livre et de la Lecture, les récompenses littéraires annuelles les plus importantes au Chili. Sartre et la Citroneta, son deuxième roman, a obtenu en Espagne le prestigieux Prix Biblioteca Breve.
Mauricio Electorat est né à Santiago du Chili en 1960. Après deux années d’études de journalisme et de littérature à Santiago, il s’installe à Barcelone en 1981, où il obtient une maîtrise en philologie hispanique. Petit fils de français émigrés à Valparaíso au début du XXe siècle, il choisit Paris comme lieu de résidence définitif dès 1987. Il a publié deux recueils de poésie. Son premier roman, Le Paradis trois fois par jour (Série noire, Gallimard, 1997), ainsi que son recueil de nouvelles Nunca fui a Tijuana y otros cuentos (Cuarto Propio, 2000) ont reçu le Prix de Littérature de la Ville de Santiago et le Prix du Conseil National du Livre et de la Lecture, les récompenses littéraires annuelles les plus importantes au Chili. Sartre et la Citroneta, son deuxième roman, a obtenu en Espagne le prestigieux Prix Biblioteca Breve.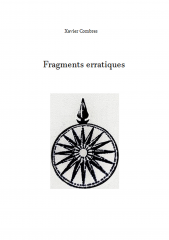 The BookEdition 2020
The BookEdition 2020
 Joca Reiners Terron est né en 1968 dans le Matto Grosso. Il vit à S
Joca Reiners Terron est né en 1968 dans le Matto Grosso. Il vit à S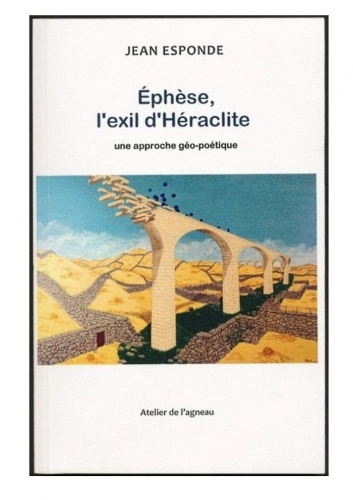
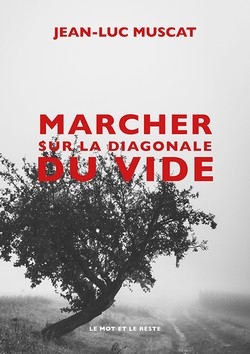 Le Mot et le reste, mai 2020. 122 pages, 13 €.
Le Mot et le reste, mai 2020. 122 pages, 13 €.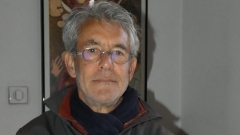 Jean-Luc Muscat, né en 1954, a appris le métier de forestier. Il a quitté l’Office National des Forêts très tôt parce qu’il ne parvenait pas à se résigner à l’idée qu’il lui fallait éliminer les arbres tordus. Dès lors, il a exercé toute une kyrielle de métiers dont ceux d’auteur de guides touristiques, de formateur consultant et d’éducateur technique. Aujourd’hui, il se consacre à la marche en solitaire au long cours, et à l’écriture, une passion de toujours, dans une cabane perchée dans un pin sylvestre.
Jean-Luc Muscat, né en 1954, a appris le métier de forestier. Il a quitté l’Office National des Forêts très tôt parce qu’il ne parvenait pas à se résigner à l’idée qu’il lui fallait éliminer les arbres tordus. Dès lors, il a exercé toute une kyrielle de métiers dont ceux d’auteur de guides touristiques, de formateur consultant et d’éducateur technique. Aujourd’hui, il se consacre à la marche en solitaire au long cours, et à l’écriture, une passion de toujours, dans une cabane perchée dans un pin sylvestre.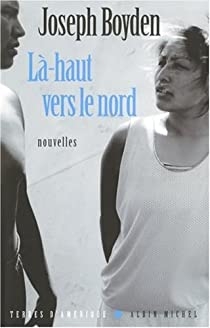 Plus le temps de faire des notes de lecture, mais toujours envie de partager mes coups de cœur. J'ai donc continué à découvrir les livres de Joseph Boyden, et j'ai encore beaucoup aimé celui-ci, de superbes et très émouvantes nouvelles qui parlent du quotidien de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants cree du Canada, écartelés entre ce qui reste de leur culture et le poids de celle qui s'est imposée à eux comme dominante et les a parqués dans des réserves.
Plus le temps de faire des notes de lecture, mais toujours envie de partager mes coups de cœur. J'ai donc continué à découvrir les livres de Joseph Boyden, et j'ai encore beaucoup aimé celui-ci, de superbes et très émouvantes nouvelles qui parlent du quotidien de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants cree du Canada, écartelés entre ce qui reste de leur culture et le poids de celle qui s'est imposée à eux comme dominante et les a parqués dans des réserves.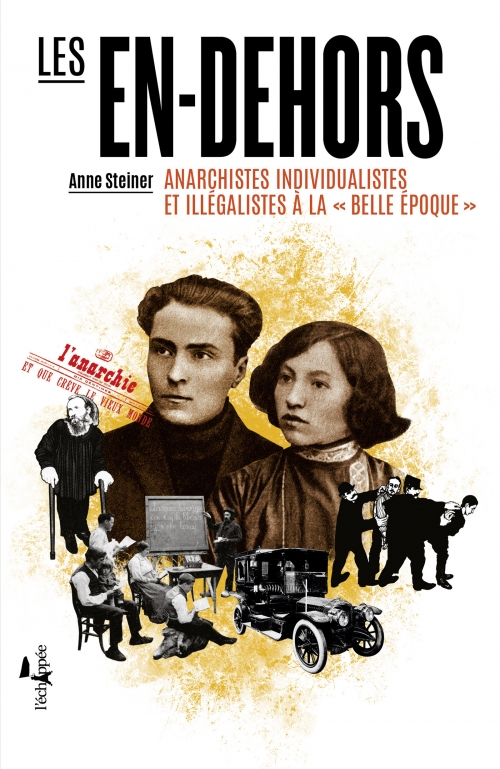
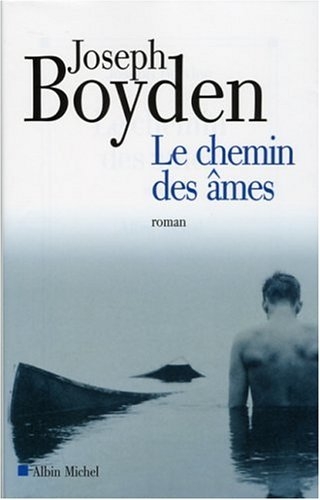
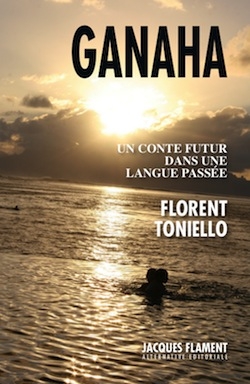
 Florent Toniello est né en 1972 à Lyon, entre Rhône et Saône. Dans une autre vie, il a été, principalement à Bruxelles, manager dans les technologies de l’information pour une grande entreprise transnationale. Une période pendant laquelle il n’a pas écrit une ligne de poésie, mais d’innombrables mémos et rapports, le plus souvent en anglais. Depuis 2012, il a rejoint les bords de l’Alzette, à Weimerskirch, au grand-duché de Luxembourg. Il se cache souvent derrière les textes des autres, s’occupant de relecture, correction et traduction pour divers éditeurs et journaux luxembourgeois. Mais il ne dédaigne pas non plus de s’adonner à l’écriture, qu’il a abordée à plus de quarante ans, mais qu’il compte bien ne pas abandonner de sitôt. Musicien de cœur depuis toujours, il a repris des études de direction d’orchestre et prépare plusieurs collaborations avec des instrumentistes.
Florent Toniello est né en 1972 à Lyon, entre Rhône et Saône. Dans une autre vie, il a été, principalement à Bruxelles, manager dans les technologies de l’information pour une grande entreprise transnationale. Une période pendant laquelle il n’a pas écrit une ligne de poésie, mais d’innombrables mémos et rapports, le plus souvent en anglais. Depuis 2012, il a rejoint les bords de l’Alzette, à Weimerskirch, au grand-duché de Luxembourg. Il se cache souvent derrière les textes des autres, s’occupant de relecture, correction et traduction pour divers éditeurs et journaux luxembourgeois. Mais il ne dédaigne pas non plus de s’adonner à l’écriture, qu’il a abordée à plus de quarante ans, mais qu’il compte bien ne pas abandonner de sitôt. Musicien de cœur depuis toujours, il a repris des études de direction d’orchestre et prépare plusieurs collaborations avec des instrumentistes.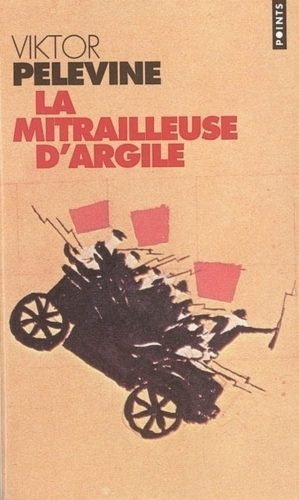
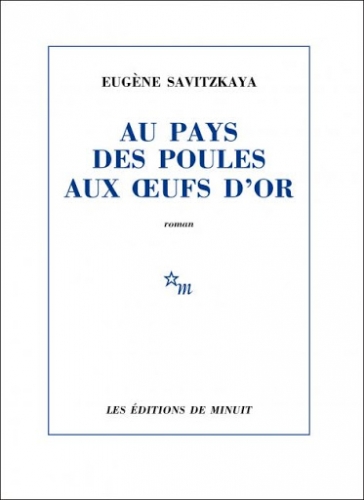
 Eugène Savitzkaya est né à Saint-Nicolas-lez-Liège en 1955. Premiers poèmes publiés en 1972 : Les Lieux de la douleur (Éd. Liège des jeunes Poètes). Il a obtenu pour
Eugène Savitzkaya est né à Saint-Nicolas-lez-Liège en 1955. Premiers poèmes publiés en 1972 : Les Lieux de la douleur (Éd. Liège des jeunes Poètes). Il a obtenu pour 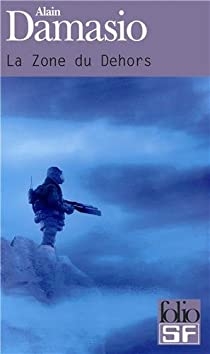

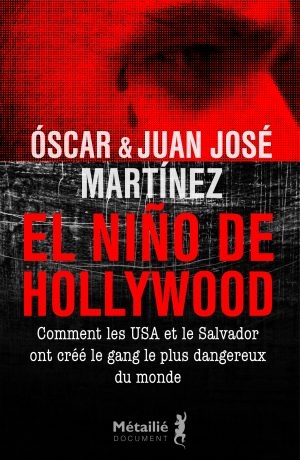
 Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse. Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.