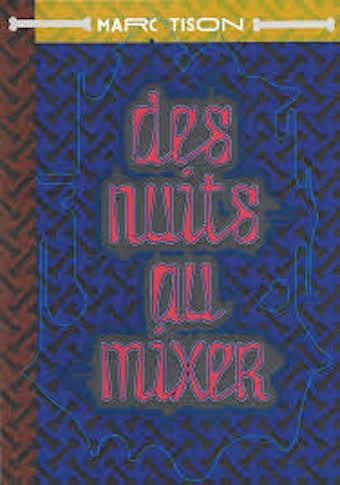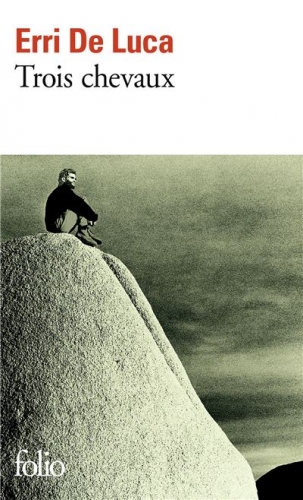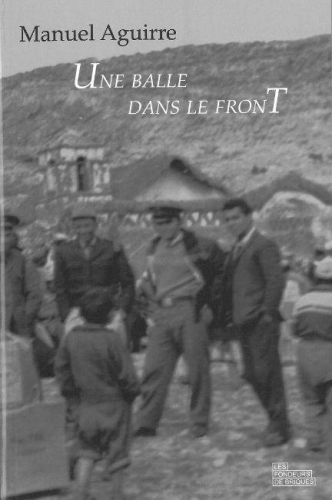illustrations de Vincent Odin
Le Calicot éd., décembre 2018
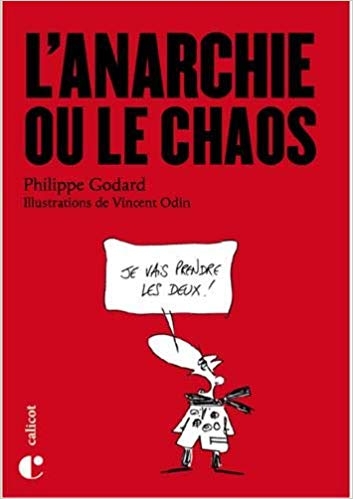
220 pages, 10 euros.
« l’édification d’une société d’êtres libres ne peut être que l’effet
de leur libre évolution » Errico Malatesta (1853-1932)
Voici un ouvrage qui amène un peu d’air frais dans le grand marécage idéologique de ce début du XXIe siècle, un air qui souffle librement sur les grandes questions contemporaines. Sont-ce vraiment des questions ? Dans la mesure où toute réponse ne visant pas à perpétuer le système tel qu’il est a peu de chances de trouver un espace officiellement autorisé d’expression, on peut s’interroger, alors disons donc : les grands problèmes contemporains. Il n’en manque pas. Le titre peut sembler ironique, tellement dans l’esprit commun anarchie et chaos semblent synonymes, mais le chaos, le grand désordre, n’est-ce pas ce que l’on vit déjà ? Cet ouvrage va donc à l’encontre des préjugés et des idées toutes faites sur un courant qui est au fond peu connu, parce qu’il est justement relégué systématiquement à la marge avec des idées et opinions tout aussi systématiquement cataloguées comme dangereuses. Pratique, pour ne pas prendre le risque qu’elles soient diffusées et donc entendues, qu’elles puissent ouvrir des brèches dans les couloirs de la pensée obligatoire. Qui dit anarchiste dit de nombreux courants, pour commencer, car il n’est pas question pour un anarchiste de se laisser enfermer dans une case, y compris celle de l’anarchie. Le point commun à tous ces courants donc, différents de par leurs orientations, leurs choix sur la mise en pratique, mais qui se rassemblent sur une vision sans compromis de l’autonomie de tout être humain, c’est le mouvement, la proposition, la créativité.
« Que pensent les anarchistes des grands défis contemporains ? Nous n’en savons rien car peu de médias importants relaient leurs idées, qui sont le plus souvent considérées comme des vieilleries utopiques ou le fruit de dérèglements cérébraux. Le monde n’a guère évolué depuis ce jour de 1892, lorsque des médecins ouvrirent la boîte crânienne de Ravachol après son exécution pour prouver que son cerveau était anormal... »
Cet ouvrage fait le tour de pas mal de ces défis et questions essentielles et offre des points de vue anarchistes donc, en évoquant et citant pas mal de figures et penseurs d’hier et d’aujourd’hui : Bakounine, Proudhon, Malatesta, Max Stirner, Emma Goldman, Kropotkine, Élisée Reclus, David Graeber, Marius Jacob, Louise Michel, Sébastien Faure, Alexandre Grothendieck, Pénélope Nin, Albert Thierry… avec un bon condensé de l’historique du mouvement, une réflexion solide et le tout non sans humour, grâce aux savoureux dessins de Vincent Odin.

Des points de vue qui peuvent apparaître radicaux, utopistes, mais si on y réfléchit bien, si on secoue un peu le formatage des esprits, ces idées sont peut-être surtout sensées, justes, évidentes, urgentes même, car contrairement à ce que l’on cherche à nous faire croire, à se faire croire, il n’y a pas qu’un seul futur possible.
Ces idées utopistes font du bien et on sait que l’expérience de la Catalogne en 1936, même si elle fut trop brève et tragique, a été une mise en application concrète et réussie des visions anarchistes. Comme l’a dit en 1974, Noam Chomsky, cette expérience fut « un témoignage éloquent de la capacité des pauvres gens de s’organiser, de s’administrer sans coercition, ni contrôle. »
Et c’est peut-être bien justement parce que cela fonctionne que les systèmes en place font tout pour dénigrer cette pensée. Quoi de plus dangereux pour un pouvoir que la preuve de son inutilité, de son illégitimité ? Quoi de plus dangereux que des êtres libres et autonomes qui peuvent prouver que non seulement un pouvoir est inutile mais qu’il est aussi néfaste et à l’origine des problèmes qu’il prétend régler, problèmes dont la récurrence lui permet en réalité de se consolider et se perpétuer ?
L’anarchie ou le chaos donne de la nourriture pour une réflexion vraiment libre et indépendante, ouvre plus largement des pistes considérées comme marginales en vue d’un mieux vivre ensemble.
Bakounine disait, lors d’une tournée de conférences en 1871 :
« Le droit à la liberté, sans les moyens de la réaliser, n’est qu’un fantôme. Et nous aimons trop la liberté pour nous contenter de son fantôme. Nous en voulons la réalité. Mais qu’est-ce qui constitue le fond réel et la condition positive de la liberté ? C’est le développement intégral et la pleine jouissance de toutes les facultés corporelles, intellectuelles et morales pour chacun. C’est par conséquent tous les moyens matériels nécessaires à l’existence humaine de chacun ; c’est ensuite l’éducation et l’instruction. Un homme qui meurt d’inanition, qui se trouve écrasé par la misère, qui se meurt chaque jour de froid et de faim, et qui, en voyant souffrir tous ceux qu’il aime, ne peut venir à leur aide, n’est pas un homme libre, c’est un esclave. Un homme condamné à rester toute sa vie un être brutal, faute d’éducation humaine, un homme privé d’instruction, un ignorant, est nécessairement un esclave. Et s’il exerce des droits politiques, vous pouvez être sûrs que, d’une manière ou d’une autre, il les exercera toujours contre lui-même, au profit de ses exploiteurs, de ses maîtres. […] Quant à nous, qui ne voulons ni fantômes, ni néant, mais la réalité humaine vivante, nous reconnaissons que l’homme ne peut se sentir libre et se savoir libre — et par conséquent ne peut réaliser sa liberté — qu’au milieu des hommes. Pour être libre, j’ai besoin de me voir entouré, et reconnu comme tel, par des hommes libres. Je ne suis libre que lorsque ma personnalité se réfléchissant, comme dans autant de miroirs, dans la conscience également libre de tous les hommes qui m’entourent, me revient renforcée par la reconnaissance de tout le monde. La liberté de tous, loin d’être une limite de la mienne, comme le prétendent les individualistes, en est au contraire la confirmation, la réalisation et l’extension infinie. Vouloir la liberté et la dignité humaine de tous les hommes, voir et sentir ma liberté confirmée, sanctionnée, infiniment étendue par l’assentiment de tout le monde, voilà le bonheur, le paradis humain sur terre. »
Philippe Godard prend un par un tous les sujets cruciaux : la liberté bien-sûr, condition première d’un être épanoui et donc bon pour lui-même et pour les autres car, écrit-il, « la liberté n’est pas la possibilité de faire n’importe quoi, d’oppresser, de réduire en esclavage. Rendre dépendant qui que ce soit, ce n’est pas nous rendre libre : c’est nous rendre exploiteur, et, donc, sortir de la condition libre qui est celle de l’humanité, pour entrer dans une autre sphère, celle du pouvoir. À l’inverse, échanger avec des êtres libres, travailler, jouer ou cultiver un champ, tisser des liens d’amitié ou d’amour avec des personnes libres, sans la moindre contrainte, est la plus intense réalisation de soi. Lorsque nous éprouvons que nous sommes semblables les uns les autres, que, toutes et tous, nous sommes libres, alors, notre association n’en est que plus forte, plus enthousiasmante. »
La philosophie anarchiste est une des seules à souligner, faisait remarquer Emma Goldman (1869-1940), que l’évolution humaine, son bien-être physique, ses qualités latentes et ses dispositions innées doivent seuls déterminer la nature et les conditions du travail d’un homme.
La question du pouvoir, radicalement remis en cause par la pensée anarchiste, est bien évidement abordée, ainsi que celle du vote et, par extension, ce que nous appelons démocratie (ou démocrature ?). Et puis encore : l’individu, le collectif et le penser collectif, l’argent et son corollaire, la consommation : « De nos jours […] : un billet de 20 euros n’indique pas qu’il correspond à la moindre contre-valeur en or ; il n’a de valeur que si le système perdure et s’il se trouve des commerçants pour l’accepter. […] Ce système mourrait si nous pouvions vérifier simultanément tous les comptes : aussitôt, les créanciers s’apercevraient qu’ils ne peuvent pas être tous remboursés, et le système s’effondrerait. »
Il y est inévitablement aussi question de la violence et de la non-violence et Philippe Godard démontre, et ce n’est pas un détail, que l’usage de la violence n’a jamais obtenu l’adhésion de l’ensemble des anarchistes et « dès la période de propagande par le fait, dans les années 1890, le doute s’était installé […] à propos de l’utilité politique de la violence » et en 1920, Errico Malatesta demandait d’y réfléchir :
« Nous ne devons pas oublier que la violence, malheureusement nécessaire pour résister à la violence, ne sert à édifier rien de bon, qu’elle est l’ennemie naturelle de la liberté, l’accoucheuse de la tyrannie, et que par conséquent elle doit être contenue dans les limites les plus strictes de la nécessité. […] La révolution est utile et nécessaire pour abattre la violence des gouvernants et des privilégiés, mais l’édification d’une société d’êtres libres ne peut être que l’effet de leur libre évolution. »
« La violence, reprend l’auteur, n’est en effet pas la voie stratégique que suivent la majorité des anarchistes. La violence "révolutionnaire" et la violence d’État sont plutôt "les deux mâchoires d’un même piège à cons", selon les deux derniers mots du héros anarchiste du film Nada (Claude Chabrol, 1974) ».
L’écologie, l’éducation — essentielle l’éducation : former les esprits, et non les déformer —, les frontières que les anarchistes refusent, la science, la folie, la notion d’illégalité seront également abordées ainsi qu’une position des plus intéressantes — et qui mériterait qu’on s’y attarde plus que jamais aujourd’hui où l’on ne peut que constater les conséquences désastreuse de la course à la réussite — : le refus de parvenir.
« Ce système nous a proposé jusqu’à maintenant d’accumuler, de vivre à fond dans l’avoir. Et il a acheté notre complicité, alors que des êtres humains n’avaient même pas la possibilité de vivre décemment. Cette misère s’étend à tout être vivant. La terreur d’État, l’asservissement industriel, l’abêtissement capitaliste et la misère sociale nous frappent toutes et tous. Insidieusement et continuellement, ces forces néfastes divisent notre être intime. Une partie de nous se voit subrepticement contrainte à être le bourreau de notre autre moi, celui qui rêve, sait et veut que ce monde ne soit pas celui-là. Combien d’entre les citoyens tentent difficilement de défaire la nuit ou pendant leur maigre temps libre ce dont ils ont été complices chaque jour travaillé ? » C’est ce qu’on peut lire dans un manifeste anarchiste dans les années 2008-2009 pendant la crise des subprimes.
Philippe Godard, lui, écrit :
« La coopération, la réflexion sur ce que nous produisons et ce que nous consommons, sont une part essentielle de l’utopie anarchiste, une utopie pas si irréaliste que cela si nous pensons à toutes les tentatives actuelles pour consommer autrement, consommer moins, beaucoup moins, de façon écologique et respectueuse du travail des autres. »
L’anarchie ou le chaos est un ouvrage riche, dense et salutaire, nourriture saine pour l’esprit, manuel de secours pour temps agités et dont on pourrait tirer encore un grand nombre de citations, mais laissons le dernier mot à Élisée Reclus, géographe anarchiste, qui écrivait en 1866 :
« Là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s’éteignent, les esprits s’appauvrissent, la routine et la servilité s’emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Parmi les causes qui dans l’histoire de l’humanité ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitaient la terre nourricière. Ils abattaient les forêts, laissaient tarir les sources et déborder les fleuves, détérioraient les climats, entouraient les cités de zones marécageuses et pestilentielles ; puis, quand la nature, profanée par eux, leur était devenue hostile, ils la prenaient en haine, et, ne pouvant se retremper comme le sauvage dans la vie des forêts, ils se laissaient de plus en plus abrutir par le despotisme des prêtres et des rois. »
Alors, l’anarchie ou le chaos ?
Cathy Garcia
 Écrivain prolixe et directeur de collection, Philippe Godard a beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine et en Inde. Il a étudié des langues dites « orientales » (chinois, bengali, hindi, haoussa, amharique, quechua) et est devenu claviste, puis correcteur. Puis encore rewriter, et enfin auteur de notices pour l’encyclopédie Hachette multimédia durant sept ans.
Écrivain prolixe et directeur de collection, Philippe Godard a beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine et en Inde. Il a étudié des langues dites « orientales » (chinois, bengali, hindi, haoussa, amharique, quechua) et est devenu claviste, puis correcteur. Puis encore rewriter, et enfin auteur de notices pour l’encyclopédie Hachette multimédia durant sept ans.
Sentant venir la fin de cette encyclopédie (et aussi la fin de l’idée même d’une encyclopédie telle que pensée par les Lumières), il a proposé une première collection de documentaires jeunesse chez Autrement : « Junior Histoire », dont les premiers titres sont parus en 2001, et qui en compte désormais vingt-cinq.
Il a ensuite lancé d’autres collections : « Les Insoumis » chez un petit éditeur strasbourgeois (qui a disparu), « Enfants d’ailleurs » chez La Martinière (13 titres parus depuis 2005, la plupart traduits et publiés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne), et il a repris la collection « J’accuse », chez Syros.
Il a aussi publié plusieurs essais politiques, dont un avec Henri Lefebvre sur le terrorisme en 1990, puis Contre le travail des enfants (Desmaret, Strasbourg, 2001) et Contre le travail (Homnisphères, 2005) et Au travail les enfants ! (Homnisphères, 2007).
Il a publié de nombreux articles politiques, notamment dans la revue italienne Libertaria, intervient en milieu scolaire, fait des conférences sur des sujets sensibles. Il a fourni durant trois ans l’épicerie Fauchon en citrouilles, et a travaillé avec sa compagne à la fourniture en légumes d’un restaurant deux étoiles durant cinq ans.
Depuis 2011, il donne des cours sur la pédagogie à de futurs travailleurs sociaux, éducatrices et éducateurs de jeunes enfants, éducateurs et éducatrices spécialisé.e.s.). Ce travail pédagogique s'inscrit en continuité de son travail éditorial, et c'est ainsi qu’il a publié, en 2017, Croire ou pas aux complots ?, qui est un véritable livre-outil, au service non seulement des jeunes mais aussi des éducateurs, spécialisés ou issus de l'Éducation nationale (aux éditions du Calicot).
Philippe Godard vit, écrit et travaille dans le Jura.


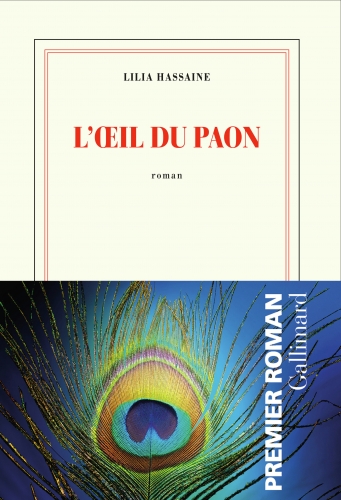
 Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
 Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.

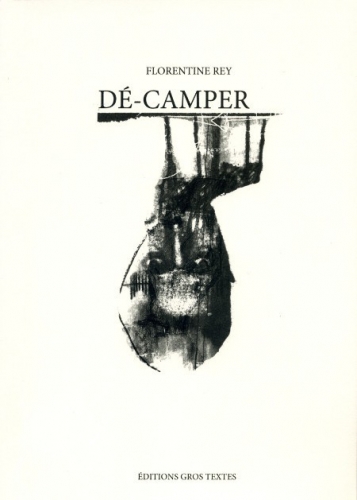

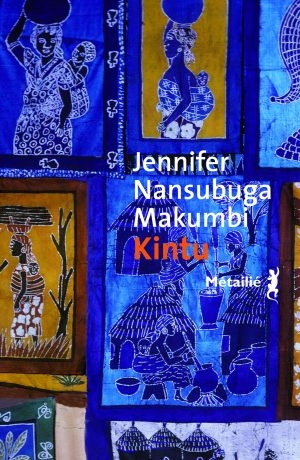


 Derrière Mix ô ma prose se cache Olivier Boyron, un Viennois d’origine qui a eu le privilège de grandir dans la « vallée de la mort ». Malgré un cadre apaisant et propice au recueillement, il peine à s’adapter au monde qui l’encercle. Pour lui, le chaos n’est déjà plus une théorie mais une réalité dont il dépassera la friction au travers de nombreuses expériences : écriture, dessins, peintures, théâtre de rue… Mix ô ma prose, lui, nait en 2002 d’une rencontre avec le slam dont il devient un des pionniers en Rhône-Alpes avec La Section lyonnaise des Amasseurs de Mots et Les Polysémiques, association qu’il fonde à la même période. En 2006 il co-fonde La Tribut du Verbe, une compagnie de slam poésie qui propose toujours spectacles et performances. En 2016 Les Polysémiques rajoutent une branche éditions à leurs activités, il en devient le responsable d’éditions. Malgré tout, toujours mal à l’aise avec les conventions, il stoppera net sa déjà courte bio.
Derrière Mix ô ma prose se cache Olivier Boyron, un Viennois d’origine qui a eu le privilège de grandir dans la « vallée de la mort ». Malgré un cadre apaisant et propice au recueillement, il peine à s’adapter au monde qui l’encercle. Pour lui, le chaos n’est déjà plus une théorie mais une réalité dont il dépassera la friction au travers de nombreuses expériences : écriture, dessins, peintures, théâtre de rue… Mix ô ma prose, lui, nait en 2002 d’une rencontre avec le slam dont il devient un des pionniers en Rhône-Alpes avec La Section lyonnaise des Amasseurs de Mots et Les Polysémiques, association qu’il fonde à la même période. En 2006 il co-fonde La Tribut du Verbe, une compagnie de slam poésie qui propose toujours spectacles et performances. En 2016 Les Polysémiques rajoutent une branche éditions à leurs activités, il en devient le responsable d’éditions. Malgré tout, toujours mal à l’aise avec les conventions, il stoppera net sa déjà courte bio.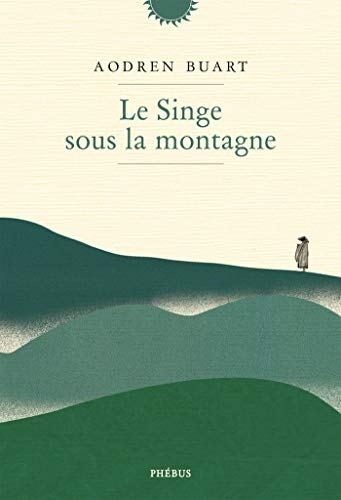

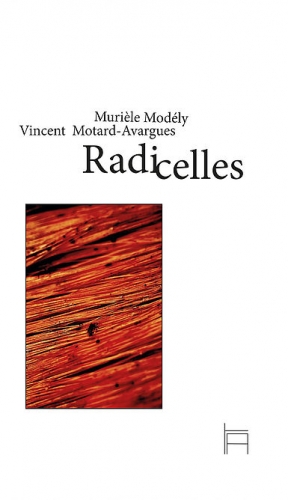

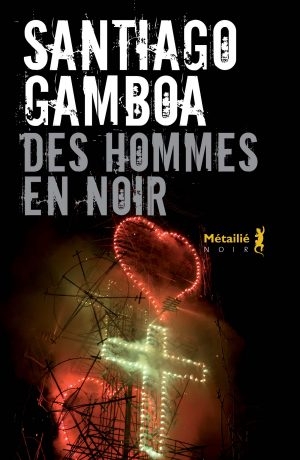

 Benoît Sourty est scénariste et réalisateur. Il dirige la pédagogie d’une école de cinéma.
Benoît Sourty est scénariste et réalisateur. Il dirige la pédagogie d’une école de cinéma. 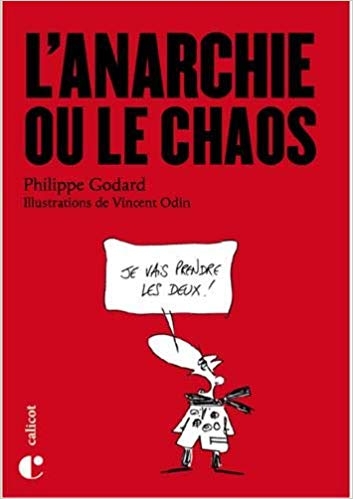

 Écrivain prolixe et directeur de collection, Philippe Godard a beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine et en Inde. Il a étudié des langues dites « orientales » (chinois, bengali, hindi, haoussa, amharique, quechua) et est devenu claviste, puis correcteur. Puis encore rewriter, et enfin auteur de notices pour l’encyclopédie Hachette multimédia durant sept ans.
Écrivain prolixe et directeur de collection, Philippe Godard a beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine et en Inde. Il a étudié des langues dites « orientales » (chinois, bengali, hindi, haoussa, amharique, quechua) et est devenu claviste, puis correcteur. Puis encore rewriter, et enfin auteur de notices pour l’encyclopédie Hachette multimédia durant sept ans.