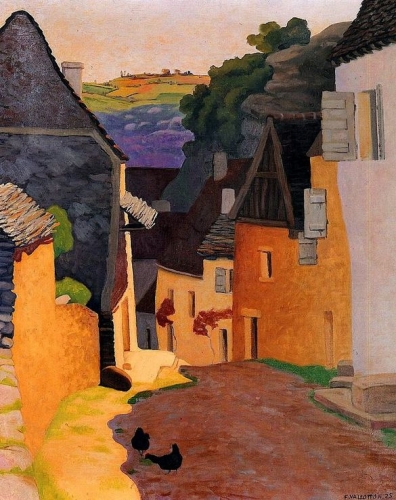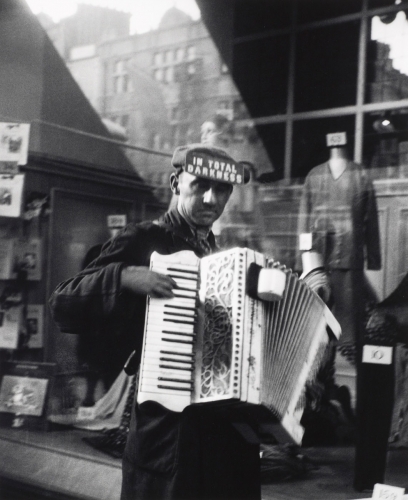Peter Sculthorpe - Moonlight over the farm - 2009
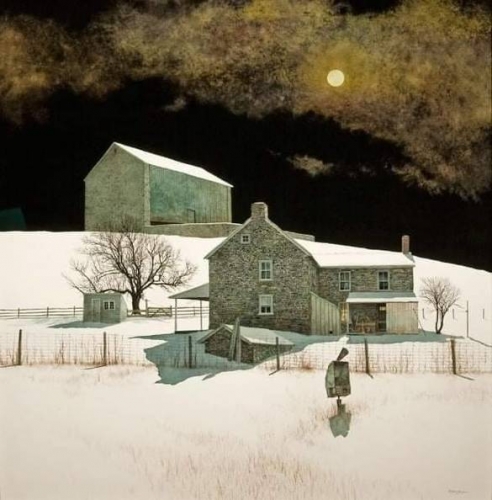
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
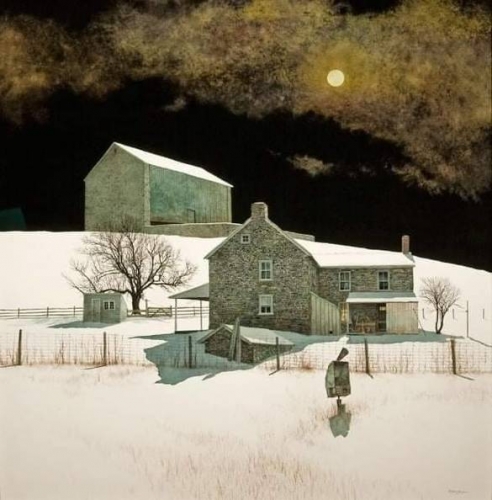



Depuis ta mort
je ne peux plus voir
un arc-en-ciel
sans pleurer
mais cette émotion
qui m'étreint
est si belle