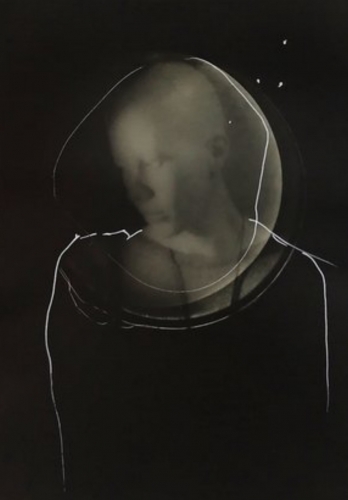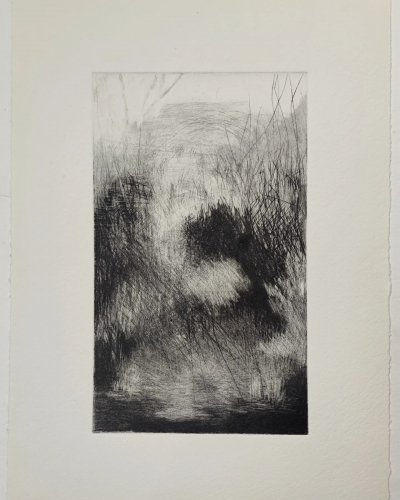D'où viennent les humains qui peuplent la France ?
Pour remettre un peu les gens et leurs idées en place :
"Il y a 30 000 ans, Homo sapiens peignaient les grottes de Lascaux. Leur peau était sombre. De récentes études d'ADN révèlent des origines lointaines et des rencontres inattendues. Qui étaient les ancêtres des Européens d’aujourd’hui ?
Notre espèce vit en Europe depuis seulement 40 000 ans. Nous, les Homo sapiens, sommes nés en Afrique. Il y a environ 70 000 ans, certains de nos ancêtres quittent ce continent pour peupler planète, dont l’Europe et l’Asie, où ils rencontrent d’autres populations humaines, comme les Néandertaliens, mais aussi d'autres groupes d'humains.
Dans cette chronique Fil Sciences de France Culture, Évelyne Heyer nous invite à explorer nos origines pour mieux comprendre que nous avons tous des ancêtres migrants ! Mais qui étaient nos ancêtres européens ? Comment les migrations et métissages anciens ont-ils façonné les Européens d’aujourd’hui, et d’où viennent leurs caractéristiques, comme la couleur de peau ?
2 % de notre ADN vient des Néandertalien
Les Néandertaliens, installés en Eurasie depuis plusieurs centaines de milliers d’années, sont également issus d’une autre sortie d’Afrique, beaucoup plus ancienne.
Lors de la dispersion des Homo sapiens hors d’Afrique, nos ancêtres ont échangé des gènes avec les Néandertaliens : ils ont fait des bébés ensemble.
Ainsi, la majorité des Européens ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Après la disparition des Néandertaliens, Homo sapiens devient la seule espèce humaine à vivre sur la planète, et il va continuer de la parcourir !
Le métissage des ancêtres européens
De récentes études, comparant l’ADN des Homos sapiens européens contemporains à celui d’Homo sapiens vieux de plusieurs milliers d’années, montrent que la majorité des Européens d’aujourd’hui descende d’au moins trois groupes d’humains, ayant migré en Europe à différentes époques :
Le premier groupe : les chasseurs‑cueilleurs du Paléolithique, présents il y a 40 000 ans.
Le deuxième : les agriculteurs venus du Proche-Orient, arrivés il y a 8 000 ans.
Enfin, le troisième : les bergers nomades Yamnayas de Russie, installés en Europe il y a environ 4 500 ans.
La peau claire en Europe : un héritage récent du Proche-Orient
Selon Raphaëlle Chaix, chercheuse en anthropologie génétique pour le Musée de l'homme, sur un plan anthropologique et même génétique la notion de femme ou d’homme français n’a pas de sens.
La couleur de peau blanche n’est d’ailleurs pas apparue en France ou en Europe de l’Ouest, elle proviendrait de gènes portés par un groupe d’humains venus du Proche-Orient, il y a environ 8 000 ans.
Le continent européen et donc la France, ont bien été habités plus longtemps par des humains à la peau sombre (comme l’Homme dit de Cro-Magnon par exemple) que par des humains à la peau claire. Cette couleur de peau est apparue très récemment à l’échelle de l’histoire de l’Europe !
Les Français : le fruit de milliers d’années de migrations
Les humains qui peuplent la France viennent donc d’un peu partout…
Une population est en effet rarement le fruit d’une seule migration. Elle est la somme de différentes migrations qui se sont opérées depuis des milliers d’années, et qui sont d’ailleurs toujours en cours.
Dans les arbres généalogiques, il suffit parfois de remonter sur deux ou trois générations, pour trouver des ancêtres d’autres régions, d’autres pays, avec une histoire migratoire différente. Nous avons tous des ancêtres migrants !"
à écouter ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-fil-sciences/d-ou-viennent-les-humains-qui-peuplent-la-france-1271114